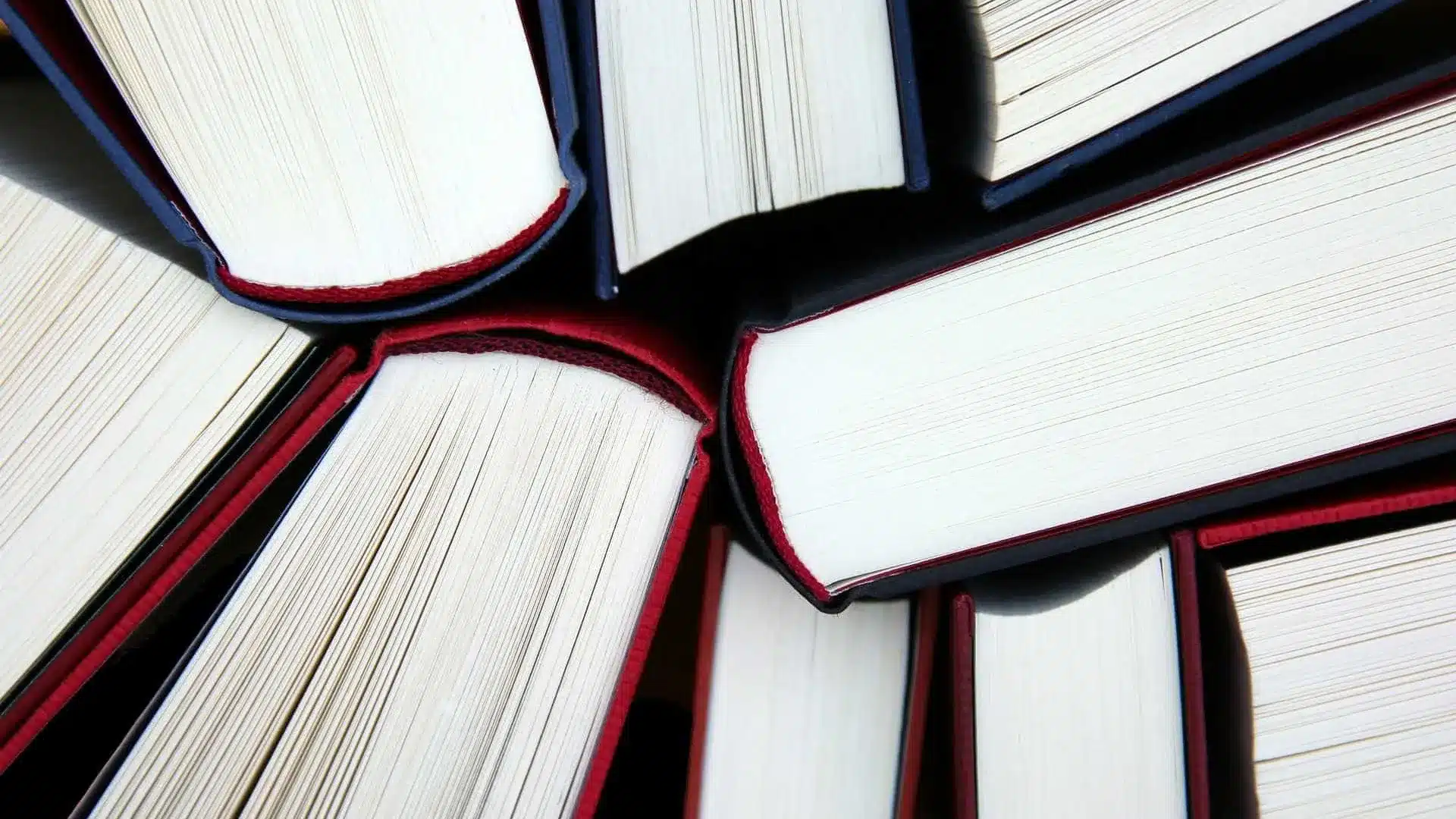« Je ne parle pas seulement des gouvernements et des parlements, même au niveau des mairies, des institutions, [elles sont] très fermées, elles n’ont pas réussi, sauf de rares et honorables exceptions, à s’ouvrir et à créer des espaces de dialogue constant et de participation avec la population », a constaté, lors d’une conversation, l’auteur de l’œuvre « A cidade e a revolução. Lutas urbanas em Lisboa 1974-1975 » (Tinta da China), déjà disponible en librairies.
Professeur d’Histoire contemporaine à l’Université de Cambridge, Pedro Ramos Pinto a travaillé au cours de la dernière décennie sur les inégalités et les luttes sociales, remarquant « une certaine distance, un certain élitisme » de ceux qui ont dirigé le régime démocratique au cours du dernier demi-siècle.
Ce fossé a créé « une méfiance très grande envers le système politique et le système de l’État », qui a abouti à la « crise de la démocratie que nous voyons aujourd’hui », indique-t-il, soulignant également d’autres facteurs, tels que les « inégalités criantes » et « un sentiment d’impuissance face à l’avenir ».
Dans ce contexte, l’historien suggère « une ouverture par rapport à ce que les gens veulent, quelles sont les frustrations, quelles sont les espérances » et de sortir « de ce que le chef de parti x a dit aujourd’hui contre le chef de parti y » ou « ce que le premier ministre a mangé au petit-déjeuner aujourd’hui ».
« Si on pouvait sortir de ce jeu et commencer à regarder sérieusement ce que les gens essaient de faire au quotidien, comment les gens tentent de vivre leur vie et quelles sont leurs espérances, je pense que cela améliorerait notre démocratie », plaide-t-il.
Pour cela, il faut, par exemple, réduire les « énormes obstacles » à la participation citoyenne, notamment l’investissement requis pour toute personne souhaitant, de manière extrapartisane, se porter candidate à des élections.
Soulignant qu’il n’est pas « antipartis », Ramos Pinto observe que « les partis, en général, et c’est un problème dans toute l’Europe, se sont de plus en plus refermés » et sont aujourd’hui « très centralisés », avec « de moins en moins de membres actifs » et représentant les intérêts de « groupes de plus en plus petits ».
Le porte-à-porte — qui est assez courant au Royaume-Uni, où il vit depuis des années — « n’est pas seulement une question d’essayer de gagner le vote ce jour-là, mais aussi de maintenir une relation de proximité avec les gens ».
La sphère politique portugaise « a beaucoup perdu cela », compare-t-il, notant que le parti Chega a misé sur une implantation locale, notamment en dehors des grandes villes.
Or, contrer la prolifération du discours populiste et d’extrême droite passe par « connaître les gens » et « créer de la confiance au niveau local ».
La question du logement revêt une importance particulière dans ce contexte, souligne-t-il, rappelant que « il y a des frustrations qui sont ensuite canalisées et manipulées pour attaquer l’immigration », qui découlent d’un « sentiment d’être chassé de son propre lieu, voyant ceux qui arrivent (…), alors qu’en réalité, c’est une question du prix des maisons, de la spéculation immobilière, du fait que notre gestion de la ville et du logement a eu tant de problèmes ».
Le livre dont il est l’auteur, qui fait partie de la collection « O 25 de Abril visto de fora », de la Commission commémorative des 50 ans du 25 avril, découle d’une étude sur les mouvements sociaux urbains pendant la période révolutionnaire.
En se concentrant sur la participation à Lisbonne, l’historien a choisi le logement pour analyser comment les gens « ont mis la main à la pâte pour revendiquer des droits ».
La politique, c’est la communauté, le quartier, la citoyenneté quotidienne, énumère-t-il, donnant comme exemple, pendant la période révolutionnaire, les coopératives du programme étatique de construction de logements SAAL, connu de tous, alors que le mouvement d’organisation, de commissions de résidents et d’assemblées locales « était quelque chose de beaucoup plus grand », et que le plus grand héritage a été que les gens se soient regroupés dans leurs quartiers pour y intervenir.
Assumant « une certaine frustration » du fait que « la grande majorité » des travaux sur la révolution portugaise soit « une histoire d’élites », de la gauche à la droite, « très concentrée sur un groupe restreint de personnes », Ramos Pinto a voulu s’intéresser à « un moment extraordinaire de participation populaire » et tenter de comprendre comment cela était possible.
« Dans un pays où nous parlons souvent d’une apathie historique, d’un atavisme traditionnel, comment se fait-il que, soudainement, les gens soient dans la rue, discutent, agissent, construisent l’avenir, bien ou mal ? », s’est-il interrogé, se rappelant : « Le 25 avril a été une opportunité, mais nous n’avons la révolution que parce qu’il y a tout un crescendo de contestation, de mobilisation, d’organisation, au moment où les capitaines parviennent à renverser le régime ».
Actuellement, reconnaît-il, « il y a une compartimentation de la mémoire de la période révolutionnaire », la réduisant à « des activistes de gauche radicale », alors que « la participation a été transversale à la société portugaise et est venue de la droite, de la gauche, du centre, de personnes qui ne se voyaient pas politiquement dans un groupe ou un autre, mais qui ont participé à leur manière, comme elles le pouvaient, à tout le processus ».
Ramos Pinto déclare que l’histoire des mouvements sociaux au Portugal depuis 1974 montre une augmentation de la mobilisation « de plus en plus détachée ou du moins autonome et indépendante des partis », surtout au XXIe siècle, citant les exemples des mouvements Geração à Rasca et, actuellement, du droit au logement.
« Quand les gens en ont l’opportunité et (…) qu’on leur donne de l’espace pour parler, les gens (…) ont un instinct assez participatif et démocratique », assure-t-il.
En utilisant les réseaux sociaux et de petites interventions, mais visibles, les mouvements pour le logement « ont été très efficaces pour mettre le sujet à l’ordre du jour », considère-t-il.
« Il y a une nouvelle crise du logement », avec toutefois « des contours différents » de celle vécue dans les années 1960-70, période sur laquelle son livre se penche : actuellement, « les bidonvilles » à la périphérie de Lisbonne « continuent d’exister et sont devenus plus visibles », mais maintenant, le logement est également devenu « inaccessible pour une grande partie de la classe moyenne ».