Le droit portugais en pratique : guide comparatif pour les expatriés francophones
Vous vous installez au Portugal ou y lancez un projet entrepreneurial ? Il est essentiel de comprendre le fonctionnement du droit portugais, d’autant plus que ce pays partage avec la France une tradition de droit civil tout en présentant des spécificités locales. Dans cet article, rédigé dans un style journalistique et pratique, nous passons en revue les grands domaines du droit portugais – du droit civil au droit pénal, en passant par le droit du travail, le droit fiscal, le droit des affaires et le système judiciaire – en soulignant à chaque fois les principales différences et similitudes avec le droit français. Des tableaux comparatifs vous aideront à visualiser ces comparaisons (régimes matrimoniaux, formes de sociétés, types d’impôts, etc.). Ce guide s’adresse aux expatriés, entrepreneurs et francophones curieux de mieux connaître le cadre juridique portugais.

Table des matières
Droit civil : famille, contrats et successions
Le droit civil portugais est codifié dans le Código Civil (Code civil) et couvre notamment le droit de la famille, des contrats, des obligations et des successions. Globalement, les principes de base sont semblables à ceux des autres pays de tradition civiliste (droit écrit hérité du droit romain), comme la France. Cependant, plusieurs points méritent l’attention des expatriés, en particulier en matière familiale et successorale où subsistent des différences notables entre la France et le Portugal.
Droit de la famille : mariage, unions et divorce
Le Portugal reconnaît le mariage civil entre deux personnes (y compris de même sexe depuis 2010), célébré généralement à la mairie (conservatória do registo civil). Comme en France, les époux peuvent choisir un régime matrimonial qui déterminera la gestion de leurs biens. Par défaut, en l’absence de contrat de mariage, le régime légal portugais est celui de la communauté d’acquêts (appelé comunhão de adquiridos), c’est-à-dire que les biens acquis pendant le mariage sont communs e-justice.europa.eu. Ce régime par défaut est équivalent à la communauté réduite aux acquêts en France (où les biens acquis pendant le mariage sont communs, et les biens antérieurs ou reçus par succession/donation restent propres)service-public.fr. Les futurs époux au Portugal peuvent aussi opter par contrat pour la séparation de biens (separação de bens) ou la communauté universelle (comunhão geral), tout comme il est possible en France de choisir un régime de séparation de biens ou de communauté universelle.
Attention, il existe au Portugal deux situations imposant obligatoirement la séparation de biens : si le mariage est célébré sans procédure préalable officielle, ou si l’un des époux a 60 ans ou plus au moment du mariage. En France, aucune règle d’âge n’impose un régime particulier, le régime légal reste la communauté réduite aux acquêts quel que soit l’âge des époux, sauf contrat contraire. Par ailleurs, une différence notable réside dans la possibilité de changer de régime matrimonial après le mariage : en France, les époux peuvent modifier leur régime par acte notarié (sous conditions, généralement après deux ans de mariage), alors qu’au Portugal le principe est la fixité du régime matrimonial – on ne peut pas en changer après coup, sauf rares exceptions prévues par la loi.
Le tableau ci-dessous compare les principaux aspects du régime matrimonial en France et au Portugal :
| Aspect | France | Portugal |
|---|---|---|
| Régime légal par défaut (sans contrat) | Communauté réduite aux acquêts (biens acquis pendant le mariage mis en communauté). | Comunhão de adquiridos (communauté des biens acquis après le mariage). (Séparation de biens imposée dans certains cas spécifiques, ex. mariage après 60 ans.) |
| Autres régimes matrimoniaux possibles | Séparation de biens ; Communauté universelle ; Participation aux acquêts (régime spécifique hybride). | Séparation de biens (separação de bens) ; Communauté universelle (comunhão geral) ; accords matrimoniaux personnalisés dans les limites de la loi. |
| Changement de régime après mariage | Possible par acte notarié après 2 ans de mariage (avec homologation judiciaire si des créanciers ou enfants sont en jeu). | En principe interdit (le contrat de mariage ne peut être modifié après la célébration, sauf cas très limités prévus par la loi). |
| Union hors mariage | PACS (Pacte civil de solidarité) : union civile enregistrée offrant certains droits (fiscaux, sociaux) similaires au mariage, mais pas de régime matrimonial communautaire et pas de droit automatique dans la succession (le partenaire pacsé n'est pas héritier réservataire et doit être désigné par testament). Concubinage (union libre) reconnu mais sans statut légal ni droits successoraux. | União de facto (union de fait) : reconnaissance légale d'une vie commune stable de plus de 2 ans. Donne accès à certains droits équivalents aux couples mariés (par exemple, option pour l'imposition commune au fisc, protection sociale, droit au logement familial) mais aucun régime de biens commun n'existe entre concubins et le partenaire survivant n'est pas héritier légal par défaut (il ne peut hériter qu'en étant institué par testament). |
En pratique, pour un expatrié marié au Portugal, il est conseillé de vérifier son régime matrimonial. Si vous vous mariez avec un Portugais sans contrat, la comunhão de adquiridos s’applique par défaut. Un contrat de mariage (convenção antenupcial) peut être établi devant notaire ou à l’état civil avant la cérémonie. Notez aussi que le mariage religieux catholique peut, s’il est enregistré, produire les mêmes effets civils qu’un mariage civil (tout comme en France via le concordat, bien que le mariage religieux n’ait pas d’effet civil en France). Le divorce au Portugal peut être prononcé soit par consentement mutuel (procédure généralement administrative devant l’état civil, rapide, si les deux époux s’accordent sur les termes) soit pour motifs contentieux devant le tribunal. Le Portugal a introduit le divorce sans faute dès 2008, permettant à l’un des époux de demander un divorce unilatéralement après une séparation de fait prolongée ou en cas de désunion irrémédiable. Cela rapproche le droit portugais de la France, où le divorce pour altération définitive du lien conjugal ou le divorce par consentement mutuel existe également. Une différence pratique : en France, depuis 2017, le divorce par consentement mutuel ne passe plus devant le juge mais se fait par acte sous seing privé contresigné par avocats et déposé chez un notaire, tandis qu’au Portugal le divorce par consentement mutuel se fait via les Conservatórias (services de l’état civil) avec homologation d’un accord écrit.
En ce qui concerne les enfants et l’autorité parentale, les deux pays appliquent le principe de coparentalité. Au Portugal, l’autoridade parental (autorité parentale) est exercée conjointement par les deux parents, y compris après une séparation, sauf décision contraire du tribunal – un principe aligné sur le droit français (autorité parentale conjointe). Les différends relatifs aux enfants (garde, pension alimentaire) sont tranchés par les Tribunaux de Família e Menores (tribunaux de la famille et des mineurs) au Portugal, comparables aux juridictions familiales françaises.
Successions et héritages
Le droit des successions portugais présente un régime de réserve héréditaire proche du droit français, avec cependant quelques particularités importantes pour les familles binationales (avocat francophone successions au Portugal). Au décès d’une personne, la succession portugaise est soumise aux règles du Code civil (Livre V – Direito das Sucessões). Le Portugal, comme la France, protège les héritiers proches par la réserve héréditaire : les descendants et le conjoint survivant sont des héritiers légitimes (herdeiros legitimários) qui ont droit à une part minimale de l’héritage montepio.org.
Qui sont les héritiers réservataires ? En France, ce sont les descendants (enfants, petits-enfants…) et, à défaut d’enfants, le conjoint survivant devient réservataire daylitis.fr. Le conjoint n’est donc héritier réservataire que s’il n’y a pas de descendant (les parents du défunt peuvent aussi être réservataires en l’absence d’enfant, ce qui est un cas rare). Au Portugal, la notion d’héritier réservataire (legitimário) inclut toujours le conjoint, les descendants et les ascendants (parents) en ligne directe. Concrètement, cela signifie qu’au Portugal le conjoint survivant est automatiquement copropriétaire de la réserve héréditaire même en présence d’enfants, alors qu’en France le conjoint n’a pas de réserve si des enfants existent (il peut même être écarté par testament, bien que la loi lui accorde d’autres protections comme le droit viager au logement). Par exemple, si un défunt laisse un conjoint et des enfants en Portugal, les héritiers réservataires (conjoint + enfants) ont ensemble droit à 2/3 de la succession (la quota legítima), contre 1/3 de quotité disponible cgd.pt. En France, si un défunt laisse un conjoint et des enfants, la réserve est entièrement pour les enfants (1/2 s’il y a un enfant, 2/3 s’il y en a deux, 3/4 s’il y en a trois ou plus) et le conjoint n’a pas de réserve, mais il hérite de droit d’une quotité dans la succession en l’absence de testament (par exemple 1/4 en pleine propriété ou l’usufruit total, au choix).
En pratique, pour un expatrié français marié à un Portugais, il est crucial de faire un testament clair si l’on souhaite avantager son conjoint ou respecter d’autres volontés, en tenant compte des règles de réserve des deux pays. Grâce aux règles européennes (règlement Bruxelles IV sur les successions internationales), on peut choisir la loi de sa nationalité pour régir sa succession, ce qui peut permettre à un Français résidant au Portugal d’appliquer le droit français (mais attention aux implications, consultez un notaire).
Concernant la procédure : la succession s’ouvre avec un acte de décès et une déclaration de succession (participação de óbito) à déposer aux autorités fiscales portugaises dans les 3 mois, listant les héritiers et les biens. Le partage peut se faire à l’amiable entre héritiers, formalisé par acte notarié, ou en justice en cas de désaccord.
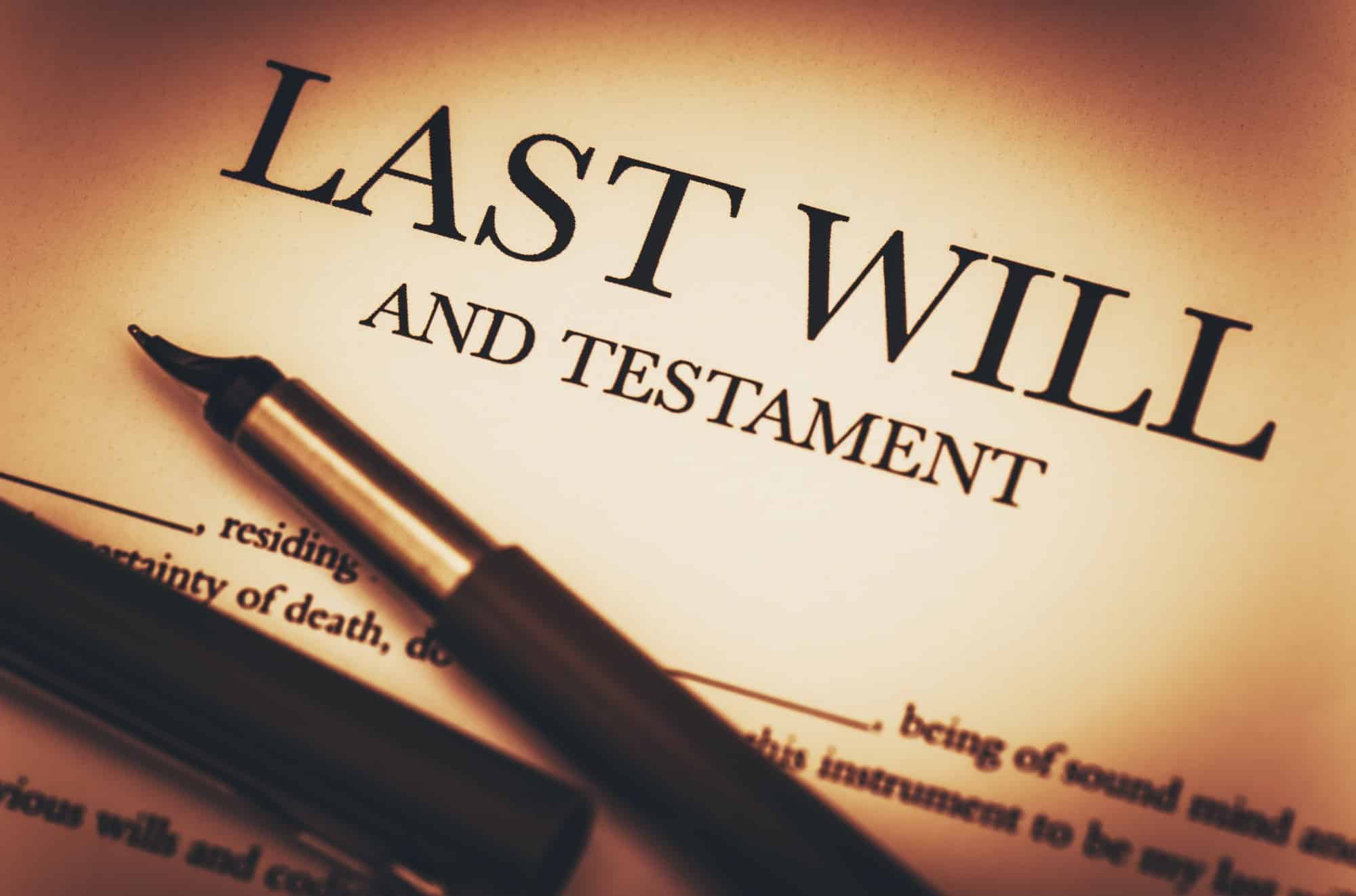
Fiscalité successorale (voir aussi le volet fiscal plus loin) : Bonne nouvelle pour les familles, il n’y a aucun droit de succession au Portugal entre parents proches. En effet, depuis 2004 le Portugal a supprimé les droits de succession classiques, ne maintenant qu’un impôt de timbre (Imposto do Selo) sur les successions et donations, au taux unique de 10%. Et ce droit de timbre ne s’applique pas au conjoint survivant, au partenaire d’une união de facto, aux descendants ni aux ascendants, qui en sont exonérés. Autrement dit, en ligne directe ou entre époux/partenaires, on hérite sans payer d’impôt (seules les formalités de déclaration aux Finanças sont requises).
En France, en comparaison, les enfants bénéficient certes d’un abattement de 100 000 € mais au-delà les héritages sont taxés par tranches jusqu’à 45%, et les frères/sœurs ou tiers peuvent être fortement taxés (sauf conjoint/PACS qui sont exonérés depuis 2008) service-public.fr. Ainsi, un expatrié qui s’établit au Portugal et y décède en laissant sa succession à son conjoint et à ses enfants verra ceux-ci exonérés d’impôt portugais sur l’héritage, ce qui est un atout appréciable du système fiscal portugais.
Pour finir sur les successions, mentionnons le droit du conjoint survivant au logement familial en Portugal : même s’il n’est pas propriétaire du logement, le conjoint survivant (ou le partenaire en união de facto depuis plus de 2 ans) a le droit d’y demeurer pendant au moins cinq ans, ou plus longtemps proportionnellement à la durée de la vie commune au-delà de 5 ans. Il bénéficie aussi d’un droit de préférence pour racheter le logement. Ce type de protection du logement du conjoint veuf existe aussi en France (droit temporaire au logement d’un an, droit viager au logement sous conditions).
Contrats et obligations
Le Portugal et la France ayant une tradition de droit civil, leurs règles en matière de contrats et obligations sont fondamentalement similaires sur de nombreux points. Au Portugal, le Code civil consacre des principes généraux très proches de ceux du Code civil français : liberté contractuelle, nécessité d’un consentement libre et éclairé, cause licite du contrat, etc. Un contrat (contrato) se forme par l’échange d’offres et d’acceptations, et une fois valablement conclu, il fait loi entre les parties (pacta sunt servanda).
Le Code civil portugais encadre également la responsabilité civile (responsabilidade civil), qu’elle soit contractuelle (inexécution d’un contrat) ou extracontractuelle (délictuelle). Par exemple, en cas de dommages causés à autrui, la règle de base est l’obligation de réparer intégralement le préjudice, tout comme en droit français (responsabilité civile délictuelle fondée sur l’article 1240 ancien 1382 du Code civil français).

Quelques différences ou points d’attention pour les expatriés :
Forme des contrats : La plupart des contrats peuvent être verbaux ou écrits au Portugal, mais certains exigent une forme authentique ou écrite (ex: vente immobilière requérant un acte notarié, tout comme en France). Les contrats de vente, de bail (contrato de arrendamento), de travail, etc., ont des dispositions spécifiques dans la loi portugaise, à consulter au cas par cas.
Régime de l’obligation : Le Portugal distingue obligations pécuniaires et morales, reconnaît la compensation, la novation, etc., de manière comparable à la France. Cependant, les taux d’intérêt légal et de retard peuvent différer (au Portugal, un taux d’intérêt légal est fixé périodiquement par le gouvernement pour les dettes civiles).
Protection du consommateur : Le Portugal, comme la France, a transposé les directives européennes de protection des consommateurs. Les contrats conclus par un consommateur bénéficient de garanties (droit de rétractation de 14 jours pour les ventes à distance, garantie légale de conformité de 3 ans depuis 2022 en UE, etc.). Un expatrié consommateur au Portugal aura donc des droits comparables à ceux qu’il connaît en France.
En somme, pour les contrats courants (achat d’une voiture, souscription d’un abonnement télécom, location d’un appartement…), le cadre n’est pas déroutant. Il est toutefois conseillé de faire traduire ou expliquer les clauses avant de signer un contrat en portugais si l’on n’est pas à l’aise avec la langue.
Droit pénal : crimes et délits
Le droit pénal portugais est régi par le Código Penal (Code pénal) de 1982 (avec de nombreuses révisions ultérieures) et par le Código de Processo Penal (Code de procédure pénale). Il définit les infractions (crimes et délits) et leurs peines, et organise la procédure de poursuite des infractions. Pour un non-juriste expatrié, il n’est pas nécessaire de connaître en détail le Code pénal, mais quelques aspects marquants du système pénal portugais méritent d’être connus, notamment en comparaison du système français.
Classification des infractions : Le Portugal ne distingue pas trois catégories comme en France (contraventions, délits, crimes), mais on peut assimiler les “crimes” portugais aux délits et crimes français (toute infraction pénale poursuivie devant un tribunal) et les “contraordenações” aux contraventions (infractions administratives).
En effet, de nombreuses infractions mineures (routières, amendes administratives) sont qualifiées de contraordenação et traitées par des autorités administratives avec des recours judiciaires éventuels, sans que cela crée un casier judiciaire. C’est similaire à la France où les contraventions (ex: un excès de vitesse) relèvent du tribunal de police et ne constituent pas des « crimes ».

Échelle des peines : Le Portugal se singularise par l’absence de peines extrêmement lourdes. La Constitution portugaise interdit la peine de mort (abolie dès le XIXe siècle pour les crimes de droit commun) et interdit également les peines perpétuelles ou de durée illimitée. Ainsi, la peine de prison à vie n’existe pas au Portugal – la peine maximale de réclusion est généralement de 25 ans de prison, même pour les crimes les plus graves iscet.pt. En France, la réclusion criminelle à perpétuité existe pour certains crimes (terrorisme, parricide, assassinats…), avec des périodes de sûreté, ce qui constitue une différence majeure. Par exemple, un meurtre en France peut théoriquement valoir la perpétuité (même si des aménagements sont possibles), alors qu’au Portugal, un homicide qualifié de très grave aura une peine de prison qui ne pourra excéder 25 ans.
Infractions et politiques pénales notables : Le Code pénal portugais incrimine les mêmes grands types de comportements qu’en France (vol, escroquerie, agressions, homicide, trafic de stupéfiants, etc.) avec des définitions assez proches, héritées du droit continental. Un point souvent cité est la politique très différente du Portugal en matière de drogues : depuis 2001, le Portugal a décriminalisé l’usage et la possession de drogues pour usage personnel. Concrètement, la possession de petites quantités de stupéfiants n’est plus un délit pénal au Portugal (contrairement à la France où c’est un délit passible d’une amende délictuelle et de poursuites), mais une infraction administrative pouvant entraîner confiscation de la substance et convocation devant une “commission de dissuasion” sanitaire sdg16.plus. Attention, cela ne signifie pas que les drogues sont légalisées : la vente et le trafic restent sévèrement punis, et même l’usage peut entraîner des mesures (amendes administratives, orientation médicale). Mais ce choix de santé publique a conduit à ce qu’un usager de drogue ne risque pas la prison au Portugal pour simple usage, là où en France le cadre est plus répressif (même si en pratique les usagers encourent surtout des amendes forfaitaires depuis 2020).
Âge de responsabilité pénale : Au Portugal, l’âge de la responsabilité pénale est fixé à 16 ans. En dessous de 16 ans, un mineur ne peut pas être pénalement jugé pour un crime – il peut toutefois faire l’objet de mesures éducatives dans le cadre d’une loi spéciale pour les 12-16 ans (Lei Tutelar Educativa). En France, la responsabilité pénale des mineurs est retenue dès 13 ans (avec un régime atténué et des juridictions pour mineurs), et en dessous les mineurs relèvent de mesures de protection (entre 10 et 13 ans, des sanctions éducatives restent possibles). Ainsi, un adolescent de 15 ans délinquant aura affaire à la justice des mineurs en France, alors qu’au Portugal il relèvera plutôt d’institutions éducatives spécialisées plutôt que du tribunal pénal.
Procédure pénale et garanties : Les deux pays garantissent les droits de la défense et la présomption d’innocence. Au Portugal, le Ministère Public (Ministério Público) dirige l’instruction des affaires pénales et peut classer sans suite ou poursuivre. Pour les crimes graves, un juge d’instruction (juiz de instrução) intervient pour valider la mise en accusation, un rôle comparable au juge d’instruction français, bien que leurs systèmes ne soient pas identiques (la procédure portugaise est en partie accusatoire, avec intervention du juge surtout en phase de contrôle). En cas d’arrestation, un suspect doit être présenté à un juge sous 48 heures. Le Portugal respecte la Convention européenne des droits de l’homme, de sorte qu’un Français ne sera pas dépaysé quant aux droits fondamentaux (droit à un avocat, droit de garder le silence, etc.).
Par ailleurs, les peines alternatives se développent : ainsi, des travaux d’intérêt général ou des peines de probation (sursis probatoire) sont prévus en Portugal comme en France. Le casier judiciaire (registo criminal) existe et peut être demandé pour certaines formalités (emploi auprès de mineurs, etc.). Un expatrié condamné au Portugal aura une mention sur le casier portugais et, via les échanges européens, cela peut apparaître en France également.
En somme, la sécurité au Portugal est assurée par un système pénal solide et relativement clément sur certains points (pas de perpétuité, approche sanitaire des drogues). Pour un étranger, les infractions à éviter sont évidemment les mêmes qu’ailleurs. Il convient de respecter les lois locales, par exemple en matière routière (les taux d’alcoolémie délictueux sont similaires : 0,5 g/L, et fortement sanctionnés en Portugal), de mœurs (le Portugal est un pays libéral et sûr, avec un faible taux de criminalité violente). En cas de problème, il est recommandé de se faire assister par un avocat lusophone, éventuellement francophone si possible. L’assistance consulaire française peut aussi vous guider si vous faites face à des poursuites pénales au Portugal.
Droit du travail : conditions d’emploi et protection des salariés
Le droit du travail portugais (Direito do Trabalho) est régi principalement par le Código do Trabalho (Code du travail) de 2003, modifié à plusieurs reprises, dont la dernière réforme notable date de l’« Agenda do Trabalho Digno » de 2023. Ce code encadre les relations employeur-employé dans le secteur privé (le secteur public ayant un statut séparé). Pour un expatrié ou entrepreneur, connaître les bases du droit du travail local est crucial, que ce soit pour embaucher des salariés ou pour travailler en tant qu’employé. De manière générale, le droit portugais est moins centralisé qu’en France (moins de grandes conventions collectives interprofessionnelles, mais des conventions de branche existent), et offre une certaine flexibilité aux entreprises tout en garantissant des droits essentiels aux travailleurs. Voici les points principaux, avec des comparaisons par rapport au droit français.

Contrat de travail et période d’essai
Un contrat de travail au Portugal (contrato de trabalho) peut être conclu pour une durée indéterminée (contrato sem termo), qui est la forme normale et privilégiée, ou pour une durée déterminée (contrato a termo) dans des conditions spécifiques (besoin temporaire de l’entreprise, projet précis, etc.). Le contrat à durée indéterminée offre la plus grande sécurité d’emploi, similaire au CDI français. Les CDD portugais sont en principe limités à 2 ans maximum, renouvellements compris (ou 3 ans dans certains cas particuliers), et ne peuvent être conclus que dans des situations prévues par la loi (remplacement, surcroît exceptionnel de travail, etc.), un peu comme les CDD en France qui sont encadrés (18 mois maximum sauf exceptions). Il existe aussi le contrat de travail temporaire via une agence d’intérim, et des contrats saisonniers de très courte durée.
La période d’essai (período experimental) dépend du type de contrat et du poste. Depuis les réformes récentes :
Pour un CDI, la période d’essai est en général de 90 jours pour la plupart des salariés , mais elle peut aller jusqu’à 180 jours pour les postes de cadre dirigeant ou de haute responsabilité technique, et même 240 jours dans des cas spécifiques (haute direction).
Pour un CDD de 6 mois ou plus, l’essai est de 30 jours, et de 15 jours pour un CDD plus court.
En France, la période d’essai standard d’un CDI est de 2 mois (employés) à 4 mois (cadres), éventuellement renouvelable une fois, ce qui est dans l’ensemble comparable (90 jours au Portugal ~ 3 mois). Notons qu’une particularité introduite au Portugal en 2019 a été une période d’essai de 180 jours pour les jeunes à leur premier emploi et les chômeurs de longue durée, dispositif atténué en 2023 devant les critiques. Dans les deux pays, rompre la période d’essai est possible librement (sauf abus) avec un court préavis.
Durée du travail et congés
e temps de travail portugais est un peu plus long qu’en France. La durée légale du travail au Portugal est de 40 heures par semaine (8 heures par jour maximum en règle générale). En France, la durée légale est de 35 heures par semaine (avec des dispositifs d’heures supplémentaires ou de RTT selon les cas). Ainsi, un temps plein standard au Portugal équivaut à 40h, souvent réparties sur 5 jours (8h x 5). Les heures supplémentaires (horas extraordinárias) sont encadrées – le Code du travail fixe un maximum de 2 heures suppl. par jour et un contingent annuel généralement de 150 heures (pouvant monter à 175 selon la taille de l’entreprise). Le travailleur a droit à des majorations de salaire pour ces heures : +25% pour la 1ère heure sup, +37,5% pour les suivantes, et +50% les jours fériés ou dimanches Ces majorations sont du même ordre de grandeur qu’en France (où la loi prévoit +25% puis +50%, sauf accord différent).
Les congés payés minimums au Portugal sont de 22 jours ouvrables par an (en général on compte les jours ouvrables du lundi au vendredi, ce qui correspond à 22 jours de travail, soit 4 semaines + 2 jours). En France, le minimum légal est de 5 semaines (30 jours ouvrables, soit 25 jours ouvrés). Donc, les salariés français ont légèrement plus de congés légaux (25 jours ouvrés contre 22 au Portugal). Toutefois, le Portugal compte 13 jours fériés par an (12 nationaux + le Mardi de Carnaval souvent chômé), là où la France en a 11 (certains pouvant être travaillés selon convention). Au final, le nombre de jours non travaillés peut s’équilibrer. Le Portugal prévoit en outre des congés spéciaux pour événements familiaux (mariage du salarié : 15 jours, décès d’un proche : 5 jours, etc.), un congé maternité de 120 à 150 jours rémunéré à 100% (la durée plus longue implique une rémunération légèrement réduite), et un congé paternité de 20 jours ouvrables obligatoires pour le père récemment aligné sur une durée plus proche de la France (où le congé paternité est de 28 jours calendaires depuis 2021).
Rémunération et avantages : Le salaire minimum national (SMN) portugais est fixé par le gouvernement chaque année. En 2025, il tourne autour de 820 € brut mensuels sur 14 mois (car au Portugal le salaire annuel est versé en 14 mensualités – 12 mois ordinaires + 1 mois de subsídio de férias en été + 1 mois de subsídio de Natal en décembre). Ce système fait que, par exemple, un salaire mensuel de base de 1 000 € correspond en fait à 14 000 € par an, soit l’équivalent de 1 167 € par mois sur 12 mois. En France, le SMIC 2025 est d’environ 1 747 € brut mensuels sur 12 mois (il n’y a pas de 13e mois obligatoire, sauf conventions). Les charges sociales salariales au Portugal s’élèvent à 11% du salaire brut (retenues pour la Segurança Social), tandis que l’employeur paie 23,75% de charges patronales. Ce total de ~34,75% de charges est relativement inférieur au système français où les cotisations combinées peuvent dépasser 40-45% du brut (même si en France une partie finance l’assurance maladie séparément, alors qu’au Portugal la santé est financée par l’impôt plutôt que par les charges salariales). En retour, les salariés portugais bénéficient de la sécurité sociale publique (pensions, allocations chômage) et d’un service public de santé très accessible (le SNS).
Rupture du contrat de travail et licenciement
La protection de l’emploi est garantie dans la Constitution portugaise : les licenciements sans juste motif (justa causa) sont interdits fra.europa.eu, de même qu’en France où un licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse. Les motifs de licenciement autorisés au Portugal se divisent en deux grandes catégories : la juste cause disciplinaire (faute grave du salarié) et la juste cause objective (raisons économiques, suppression de poste, inaptitude… appelées despedimento coletivo s’il s’agit d’un licenciement économique collectif, ou despedimento por extinção de posto de trabalho s’il s’agit d’un poste individuel supprimé pour motif économique, ou inaptidão pour insuffisance professionnelle avérée) moodle.adaptland.it. En France, on distingue de même le licenciement pour motif personnel (faute ou insuffisance) et le licenciement pour motif économique. Dans les deux pays, un licenciement abusif sans cause peut être contesté aux prud’hommes/tribunal du travail et donner lieu à réintégration (rare) ou indemnités.
Procédure : Au Portugal, la procédure de licenciement est formaliste. En cas de licenciement disciplinaire, l’employeur doit engager un processus interne disciplinaire avec notification des griefs et possibilité pour le salarié de se défendre par écrit, avant de pouvoir prononcer le renvoi. Pour un licenciement pour motif économique, il y a également des notifications écrites, des critères de choix en cas de postes multiples, et un préavis à respecter. Les durées de préavis varient selon l’ancienneté du salarié : 15 jours si < 1 an d’ancienneté, 30 jours si 1–5 ans, 60 jours si 5–10 ans, 75 jours au-delà cite.gov.pt. Ces durées s’appliquent en cas de licenciement économique individuel ou de licenciement pour inadaptação. En France, le préavis de licenciement est généralement de 1 à 2 mois (sauf conventions plus favorables, ou 3 mois pour les cadres) selon l’ancienneté, ce qui est d’ordre comparable. En cas de démission (denúncia du contrat par le salarié) au Portugal, le salarié doit aussi respecter un préavis (généralement 30 jours s’il a moins de 2 ans d’ancienneté, 60 jours au-delà, sauf dispense par l’employeur), sous peine de devoir indemniser l’employeur cgtp.pt.
Indemnités : Lors d’un licenciement économique au Portugal, le salarié a droit à une indemnité légale de licenciement calculée typiquement à raison de 14 à 18 jours de salaire par année d’ancienneté (selon la date de conclusion du contrat, la loi ayant changé en 2013) pgdlisboa.pt. En cas de faute grave avérée (justa causa), aucune indemnité n’est due. En France, les indemnités légales de licenciement sont d’au moins 25% de mois de salaire par année (environ 8,3 jours par an) pour les premières années et 1/3 de mois au-delà de 10 ans, donc en général un peu moins généreuses que les barèmes portugais, mais avec en plus les dommages-intérêts potentiels en cas de licenciement abusif (barème prud’homal). Par ailleurs, le Portugal permet la rupture conventionnelle (revogação por mútuo acordo) du contrat d’un commun accord avec indemnité librement négociée, tout comme la France a la rupture conventionnelle homologuée.
Relations sociales : Le taux de syndicalisation est relativement faible au Portugal, mais les salariés bénéficient de droits syndicaux et peuvent élire des délégués du personnel (delegados sindicais) dans l’entreprise. Il n’y a pas d’équivalent exact des comités sociaux et économiques français dans toutes les entreprises, mais les grandes entreprises peuvent avoir des comissões de trabalhadores (commissions de travailleurs) consultatives. Les conflits du travail non résolus en interne vont devant les Tribunais do Trabalho (tribunaux du travail) portugais, équivalents des conseils de prud’hommes français, avec possibilité d’appel.
En résumé, le droit du travail portugais offre un cadre protecteur mais un peu plus flexible sur la durée du travail. Pour un expatrié salarié, les conditions (congés, horaires, sécurité sociale) sont bonnes, même si les salaires moyens restent plus bas qu’en France. Pour un entrepreneur, le Portugal présente l’avantage de charges sociales modérées et d’une relative facilité à embaucher ou à adapter les effectifs (sous réserve de respecter la loi). Le climat social portugais est généralement calme, avec moins de grèves qu’en France, bien que des mouvements existent (transports, santé, etc.).
Droit fiscal : comparatif des principaux impôts français et portugais
Le droit fiscal portugais comporte un ensemble d’impôts nationaux et locaux comparables à ceux connus en France, bien que leur structure et taux diffèrent. Le public expatrié sera particulièrement attentif à l’imposition sur le revenu, au régime spécial des résidents non habituels, à la fiscalité immobilière et à l’absence d’impôt sur la fortune (sauf dispositif spécifique). Nous présentons ci-dessous un tableau comparatif des principaux impôts en France et au Portugal, suivi de quelques explications pratiques.
| Type d'impôt | En France | Au Portugal |
|---|---|---|
| Impôt sur le revenu des personnes physiques | Impôt progressif par tranches de 0% à 45% (taux marginal supérieur) avec système du quotient familial (parts par foyer) et prélèvement à la source. Barème 2025 approx. : 0% jusqu'à 10 800 €; 11%…45% au-delà de ~168 000 € par part. | Impôt progressif IRS (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares) avec taux de 14,5% à 48% (taux marginal à 48% au-dessus d'environ 80 000 €). Imposition individuelle par défaut (les couples mariés ou unis de fait font l'objet de deux avis d'imposition séparés, mais ils peuvent opter pour une imposition commune facultative). Régime spécial RNH (Residente Não Habitual) possible pour les nouveaux résidents étrangers : taux forfaitaire de 20% sur les revenus d'activité « à valeur ajoutée » et exonération ou taux réduit sur la plupart des revenus étrangers pendant 10 ans (par exemple, retraites étrangères imposées à 10% depuis 2020). |
| Impôt sur les sociétés (bénéfices des entreprises) | IS au taux de 25% (taux unique à partir de 2022, après réduction progressive de l'ancien 33%) sur les bénéfices des sociétés soumises à l'IS. PME bénéficient d'un taux réduit de 15% jusqu'à 42 500 € de profit (2023), et exonérations possibles (JEI, etc.). | IRC (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas) au taux standard de 21% sur les bénéfices (remarque : le Budget 2025 prévoit une baisse à 20%). Taux réduit PME de 17% sur la première tranche (25 000 € de bénéfices en 2025). Surtaxes : surtaxe d'État de 3% à 9% pour les grandes entreprises (profits >1,5 M€) et surtaxe municipale jusqu'à 1,5%. Le taux effectif pour un grand groupe peut donc approcher 31,5%. Les PME locales ont en revanche un impôt modéré. |
| Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) | TVA à taux normal de 20%. Taux intermédiaire de 10% (transports, restauration…) et taux réduit de 5,5% (alimentation de base, livres, travaux énergie…) ; super-réduit 2,1% pour presse et médicaments remboursables. | IVA (Imposto sobre o Valor Acrescentado) à taux normal de 23% (sur le continent). Taux intermédiaire de 13% et réduit de 6% sur les produits et services essentiels (similaire aux catégories françaises). Particularité : dans les régions autonomes : 16% aux Açores et 22% à Madère (taux normaux réduits localement). Exportations exonérées, comme en France. |
| Impôts locaux fonciers | Taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties, perçue par les communes (taux variables selon collectivités, assiette = valeur locative cadastrale). Taxe d'habitation supprimée pour les résidences principales depuis 2023, reste due pour les résidences secondaires et certaines locales. Droits de mutation (frais de notaire) d'environ 7-8% lors de l'achat immobilier (dont 5,8% de taxe de publicité foncière). | IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis) : impôt foncier annuel calculé sur la valeur patrimoniale cadastrale des biens immobiliers, taux typiques de 0,3% à 0,45% du valeur pour les urbains (variable par municipalité, dans ces fourchettes) et 0,8% pour les ruraux. IMT (Imposto Municipal sobre Transmissões) : taxe sur les mutations immobilières, barème progressif environ 5-6% du prix (exonération jusqu'à ~97 000 € pour une habitation principale). Impôt de timbre : 0,8% du prix à l'achat d'un bien immobilier (droit de timbre sur l'acte de vente). Pas de "taxe d'habitation" annuelle au Portugal, l'IMI tient lieu d'impôt foncier unique. |
| Droits de succession et donation | Droits de succession en ligne directe : abattement de 100 000 € par enfant ou parent, puis barème progressif de 5% à 45%. Conjoint survivant et partenaire pacsé exonérés à 100%. Frères/sœurs : abattement ~15 000 €, puis 35-45%. Étrangers non parents : taxation 60% (d'où nécessité du PACS/mariage pour un couple). Donations de parent à enfant taxées aux mêmes taux (avec abattement partagé). Droits de mutation à titre gratuit gérés par l'administration fiscale (Service des impôts français). | Pas de droits de succession classiques : uniquement un Imposto do Selo (droit de timbre) de 10% sur les héritages et donations. Sont exonérés de ce timbre le conjoint survivant, le partenaire en união de facto, les descendants (enfants, petits-enfants) et ascendants (parents) – ils ne paient donc rien du tout sur ce qu'ils héritent. Les autres héritiers (frères, non-famille, etc.) paient le timbre 10% sur la valeur reçue. Formalité : déclaration de succession aux Finanças sous 3 mois. NB : Aucune taxation des assurances-vie perçues par le bénéficiaire (pas d'équivalent du prélèvement de 20%/31,25% français). |
| Impôt sur la fortune | Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) depuis 2018, qui concerne le patrimoine immobilier net (non professionnel) > 1,3 million € par foyer. Barème progressif de 0,5% à 1,5% sur la fraction taxable au-delà de 800 000 € par personne (dû chaque année). Pas d'impôt sur la fortune mobilière en France depuis 2018. | Aucun impôt général sur la fortune mobilière ou globale. Toutefois, existe un AIMI (Adicional ao IMI) = surtaxe annuelle sur la valeur globale des biens immobiliers détenus au Portugal dépassant 600 000 € de valeur cadastrale (plafond doublé à 1,2 M€ pour les couples mariés optant pour taxation conjointe). Barème AIMI : 0,7% sur la tranche 600 k€–1M€, 1% sur 1M–2M€, 1,5% au-delà. En pratique, cela vise les gros propriétaires fonciers (par exemple un patrimoine immo de 2 M€ = ~11 000 € d'AIMI par an). Les résidences de valeur plus modeste ne sont pas concernées. |
En complément de ce comparatif, signalons quelques dispositifs fiscaux d’intérêt pour les expatriés :
Résident Non Habituel (RNH) : ce régime portugais, cité ci-dessus, mérite insistance car il a motivé de nombreuses installations. Si vous n’avez pas été résident fiscal portugais dans les 5 années précédentes, vous pouvez demander le statut Residente Não Habitual lors de votre arrivée. Une fois accordé, pendant 10 ans, vous bénéficiez d’une imposition allégée : vos revenus d’activité issus d’une liste de professions qualifiées (ingénieur, médecin, architecte, etc.) sont taxés à 20% fixe cihc.occ.pt (au lieu du barème jusqu’à 48%), et surtout, vos revenus passifs étrangers (dividendes, intérêts, loyers, pensions) peuvent être exonérés d’IRS au Portugal, à condition qu’ils aient été effectivement imposés dans le pays d’origine ou que le traité fiscal l’attribue à l’étranger. Ainsi, par exemple jusqu’en 2019, une pension de retraite française reçue par un RNH au Portugal n’était imposée ni en France (convention fiscale) ni au Portugal (exemption RNH) : une double non-imposition très avantageuse. Depuis 2020, le Portugal taxe à 10% les pensions étrangères des RNH (ce qui reste attractif comparé à une tranche à 30% ou plus). Ce régime RNH a fait du Portugal un petit « paradis fiscal » pour retraités et télétravailleurs internationaux, tout en restant pleinement légal et transparent. À noter : la loi de finances 2024 en France a introduit une exit tax sur les retraites qui viserait les expatriations motivées uniquement par la fiscalité, montrant l’attention du fisc français à ces mouvements.
Convention fiscale franco-portugaise : signée en 1971, elle évite les doubles impositions entre la France et le Portugal. En général, les revenus du travail sont imposés dans le pays d’exercice, les retraites du secteur privé dans le pays de résidence, les retraites publiques dans le pays payeur (ex: une pension de fonctionnaire français reste imposable en France uniquement). Les dividendes, intérêts, etc., peuvent subir une retenue à la source réduite en France et être imposés au Portugal, etc. Il est important de se référer à cette convention pour savoir où déclarer quoi, surtout lors de la première installation.
Impôts des entreprises : Le Portugal a de nombreux incitatifs pour les investisseurs. Par exemple, dans la Zone franche de Madère, les nouvelles sociétés bénéficiaient d’un taux d’IRC de 5%. Des crédits d’impôt pour la R&D (SIFIDE) ou l’intérieur du pays (déductions fiscales pour s’installer dans l’intérieur dépeuplé) existent. La TVA portugaise, bien que de 23%, a un système du “IVAucher” (occasionnel) pour stimuler la consommation : l’État rembourse sous forme de crédits une partie de la TVA dépensée dans certains secteurs (restaurants, hôtels…).
Globalement, la pression fiscale au Portugal est légèrement inférieure à celle de la France. Les cotisations sociales y sont plus faibles, et l’absence d’impôts sur la fortune ou sur les successions familiales est un avantage notable. En contrepartie, la TVA est un peu plus élevée et l’impôt sur le revenu peut monter jusqu’à 48% sans quotient familial (ce qui peut pénaliser les familles nombreuses sans le correctif des parts qu’on connaît en France). Il convient donc d’optimiser sa situation selon son profil (statut RNH, choix du lieu d’imposition via la convention, etc.). Faire appel à un conseiller fiscal francophone au Portugal peut s’avérer judicieux pour bien comprendre ses obligations (par exemple, déclarer ses comptes bancaires à l’étranger, etc., obligation commune aux deux pays).
Droit des affaires et des sociétés : entreprendre au Portugal
Le droit commercial portugais (Direito Comercial) et le droit des sociétés (Direito das Sociedades) sont des domaines de première importance pour les entrepreneurs et investisseurs. Le Portugal offre un environnement relativement accueillant pour les affaires, avec des démarches administratives simplifiées ces dernières années (programme “Empresa na Hora”). La structure de base est similaire au droit français (sociétés à responsabilité limitée, sociétés anonymes, entreprise individuelle), mais les formes juridiques et certaines exigences varient. Cette section compare les principales formes d’entreprises disponibles et donne un aperçu des procédures de création.

Formes juridiques d’entreprise : comparatif FR–PT
Que vous envisagiez d’exercer en nom propre ou de constituer une société, il est utile de connaître les équivalences entre la France et le Portugal. Le tableau suivant récapitule les principales formes d’entreprise des deux pays :
| Forme d'entreprise | En France | Au Portugal |
|---|---|---|
| Entreprise individuelle (activité en nom propre, sans personnalité morale) | Entrepreneur individuel (possibilité de régime auto-entrepreneur micro-social). Responsabilité illimitée sur les biens personnels (sauf déclaration d'affectation EIRL sur patrimoine professionnel). Régime fiscal : impôt sur le revenu (catégorie BIC/BNC). Possibilité d'option pour l'EURL si souhait de limiter la responsabilité. | Empresário em Nome Individual (ENI). Responsabilité illimitée également (patrimoine personnel engagé sur les dettes). Régime fiscal : impôt sur le revenu (catégorie rendimentos empresariais). Possibilité de régime simplifié (regime simplificado) avec abattement forfaitaire sur les revenus professionnels (similaire au régime micro-entreprise). |
| Société à responsabilité limitée (taille PME) | SARL (Société à responsabilité limitée) ou EURL (SARL à associé unique). Capital social libre (1 € minimum). 1 associé minimum (EURL) ou 2+ (SARL classique). Responsabilité limitée aux apports. Statut très répandu pour les PME familiales. Fiscalité à l'IS par défaut (possibilité IR si EURL personne physique). | Sociedade por Quotas – communément appelée Lda (Lda = limitada). Variante à un seul associé : Sociedade Unipessoal Lda. Capital social librement fixé (min. 1 € par quota), souvent symbolique (ex: 1 € par associé). 1 associé (Unipessoal) ou 2+ associés (Lda classique). Responsabilité limitée au montant du capital. Forme la plus courante pour les petites et moyennes entreprises. Fiscalité : soumise à l'IRC (impôt sociétés). |
| Société par actions (grandes entreprises) | SA (Société Anonyme). Capital minimum 37 000 € (légal) à constituer, apporté par actionnaires. Au moins 2 actionnaires (ou 7 si cotée en bourse). Organes de gestion obligatoires : conseil d'administration + direction (ou directoire et conseil de surveillance). Adaptée aux projets de grande envergure. Peut être cotée sur Euronext Paris. | Sociedade Anónima (S.A.). Capital minimum 50 000 € (montant prévu par la loi). Nombre d'actionnaires : en principe 5 actionnaires minimum (mais il est permis qu'une personne morale unique détienne 100% des actions, ce qui permet une S.A. unipersonnelle si l'associé unique est une société). Fonctionnement : capital divisé en actions, responsabilité limitée aux apports. Un conseil d'administration (ou directoire) est requis, avec obligation d'avoir un organe collégial si capital > 200 000 €. Peut faire appel public à l'épargne (cotée à la bourse de Lisbonne le cas échéant). |
| Autres formes sociétales | SAS (Société par Actions Simplifiée) : souplesse statutaire, capital libre (1 € min.), 1 associé possible (SASU). Forme prisée car allège les contraintes (pas de capital minimum, organes de gestion libres). SNC (Société en Nom Collectif) : associés commerçants à responsabilité illimitée et solidaire (rare). SC (Société Civile) pour professions libérales (peut prendre forme SEL). Auto-entrepreneur (micro-entreprise) : régime simplifié sans personnalité morale (évoqué en EI). | Pas d'équivalent direct de la SAS : les besoins sont couverts par la flexibilité de la Lda (qui peut avoir un seul associé et un gérant unique, tout en étant à responsabilité limitée). Formes de sociétés de personnes : Sociedade em Nome Coletivo (équivalent SNC, associés indéfiniment et solidairement responsables) et Sociedade em Comandita (Société en commandite) – peu utilisées. Il existe la Cooperativa (société coopérative) pour certains projets. Pour les professions libérales, on a des Sociedades Civis ou la possibilité d'exercer via Lda unipessoale. |
En pratique, beaucoup d’entrepreneurs étrangers au Portugal choisissent de créer une Lda unipessoal (qui correspond à une EURL/SARL unipersonnelle), car c’est simple, rapide et cela limite la responsabilité. D’autres préfèreront rester en entreprise individuelle s’ils travaillent seuls (surtout avec le régime fiscal simplificado très avantageux jusqu’à certains plafonds de revenus). Les grandes filiales de groupes internationaux adoptent souvent la forme S.A. pour des raisons de crédibilité et de gouvernance.
Création d’entreprise et démarches
Le Portugal a modernisé ses procédures de création d’entreprise, avec le dispositif Empresa na Hora (« Entreprise en une heure »). Ce service, lancé en 2005, permet de constituer une société très rapidement (parfois en moins d’une heure) en se rendant dans un guichet unique (guichet “Empresa na Hora”) justica.gov.ptjustica.gov.pt. Concrètement, les futurs associés choisissent une dénomination sociale parmi une liste de noms pré-approuvés ou présentent un certificat de nom, signent les statuts pré-rédigés (plusieurs modèles disponibles) et obtiennent immédiatement le numéro d’identification de l’entreprise (NIPC). L’entreprise est opérationnelle quasi immédiatement après cette formalité unique. C’est un vrai atout du Portugal comparé à la France où, bien que les démarches se soient simplifiées (guichet unique en ligne depuis 2023), il faut généralement quelques jours pour obtenir l’extrait Kbis d’une société.
Numéros et inscriptions obligatoires : Au Portugal, toute personne (physique ou morale) a besoin d’un NIF (Número de Identificação Fiscal) pour exister fiscalement – les expatriés doivent en demander un pour de nombreuses démarches (équivalent du numéro SIRET/SIREN pour une société, ou du numéro fiscal personnel). Une société devra également s’inscrire à la Sécurité Sociale, obtenir un numéro de TVA (généralement le NIF sert de numéro de TVA intracommunautaire). Il est conseillé de recourir à un contabilista certificado (comptable agréé) dès le début, car la loi exige que les entreprises aient un comptable certifié qui dépose les comptes et déclarations fiscales.
Coûts et capital : La création d’une Lda coûte environ 360 € de frais administratifs. Le capital peut être symbolique (ex: 1 €), mais il est souvent recommandé de mettre un capital un peu plus substantiel (ex: 1000 €) pour crédibiliser la société vis-à-vis des banques et partenaires. À noter, le capital d’une Lda n’a pas besoin d’être libéré intégralement immédiatement : les associés peuvent s’engager à le libérer plus tard.
Obligations post-création : comme en France, il faudra tenir une comptabilité, déclarer la TVA périodiquement (trimestrielle si CA modeste, mensuelle si CA important), payer les cotisations sociales (mensuellement). Le Portugal propose des régimes simplifiés d’imposition pour les petites entreprises : par exemple, si le chiffre d’affaires annuel < € (≈ ), on peut être exonéré de TVA (regime isento de IVA article 53) et opter pour un régime simplifié d’IRS/IRC où l’impôt est calculé sur une base forfaitaire (pour les indépendants). Un entrepreneur doit aussi souscrire les assurances obligatoires (par exemple, assurance accidents du travail pour lui-même s’il est gérant rémunéré).
Comparaison climat d’affaires : Le Portugal se classe généralement bien dans les classements de facilité de faire des affaires. La bureaucratie est relativement légère (beaucoup de démarches sont en ligne via le portail ePortugal). Par exemple, l’inscription d’un auto-entrepreneur (travailleur indépendant, trabalhador independente souvent appelé “recibos verdes”) peut se faire en quelques clics sur le portail des Finanças pour commencer à émettre des factures (les “reçus verts” électroniques). En France, le régime auto-entrepreneur est tout aussi simple en ligne.
Pour les expatriés entrepreneurs, deux points supplémentaires :
Langue : la plupart des démarches sont en portugais, mais on trouve des guides en anglais. Il est utile de faire appel à un avocat ou comptable parlant français au début pour éviter les erreurs.
Aides : il existe des subventions et aides à l’investissement au Portugal, notamment via les fonds européens (Portugal 2030). Par exemple, des allègements fiscaux pour s’installer dans l’intérieur du pays, des aides à l’embauche de chômeurs, etc. Le France n’est pas en reste (crédits d’impôt, subventions Bpifrance, etc.), mais un entrepreneur devra explorer les deux systèmes s’il a des activités binationales.
Système judiciaire et procédures : accès à la justice et types de juridictions
Pour clore ce panorama, abordons le système judiciaire portugais et les procédures, avec un œil comparatif sur la France. Un expatrié ou un chef d’entreprise peut être amené à interagir avec la justice locale, ne serait-ce que pour un litige civil, commercial, ou en tant que justiciable.
Organisation des tribunaux

Le Portugal est un État unitaire où la justice est rendue au nom du peuple, de manière indépendante. Il existe plusieurs ordres de juridictions, comme en France :
Juridictions civiles et pénales (ordre judiciaire) : Ce sont les Tribunais Judiciais. La base est le Tribunal Judicial de Comarca (Tribunal judiciaire de canton/district), qui est la juridiction de première instance compétente pour la plupart des affaires civiles et pénales courantes law.cornell.edu. Chaque comarca (circonscription judiciaire, il y en a 23 couvrant le territoire) comporte des tribunaux de première instance comprenant éventuellement plusieurs sections spécialisées (section civile, pénale, famille, travail, commerce…). Par exemple, un litige commercial important sera jugé en première instance par la section commerce du tribunal de la comarca, un divorce par la section famille, un crime par la section pénale.
Au-dessus, on trouve les Tribunais da Relação (Cours d’Appel), au nombre de 5 (Lisbonne, Porto, Coimbra, Évora et Guimarães). Elles réexaminent les affaires en fait et en droit. Enfin, le sommet de l’ordre judiciaire est le Supremo Tribunal de Justiça (STJ), équivalent de la Cour de cassation française, qui ne juge que le droit et assure l’unité de la jurisprudence. Ses arrêts sont définitifs.Juridictions administratives et fiscales (ordre administratif) : Le Portugal a, comme la France, un ordre séparé pour les litiges impliquant l’administration publique. Les Tribunais Administrativos e Fiscais traitent en première instance les recours contre l’État, les collectivités, les impôts, etc. Ils ont leurs propres cours d’appel (Tribunais Centrais Administrativos) et au sommet le Supremo Tribunal Administrativo (équivalent du Conseil d’État pour la section contentieux). Un particulier expatrié pourrait y recourir, par exemple, pour contester un impôt (impugnation d’une décision fiscale) ou une décision de l’urbanisme.
Tribunal Constitucional : Le Portugal dispose d’une Cour constitutionnelle, le Tribunal Constitucional, séparée des autres, chargée du contrôle de constitutionnalité des lois. En France, le Conseil constitutionnel a ce rôle (saisi de lois ou de QPC). Au Portugal, 13 juges constitutionnels peuvent être saisis pour vérifier qu’une loi ou même qu’une décision de justice ne viole pas la Constitution.
En résumé, l’architecture est assez classique. Un expatrié devrait surtout connaître le Tribunal de Comarca local (pour toute procédure civile le concernant) et la Relação en appel. Par exemple, si vous êtes assigné en justice par un fournisseur ou que vous souhaitez poursuivre quelqu’un, ce sera devant le tribunal de la comarca (section cível si civil). Notez qu’il n’y a pas d’équivalent exact des tribunaux d’instance/tribunaux de proximité comme autrefois en France : toutes les affaires civiles (peu importe l’enjeu financier) partent au tribunal judiciaire de première instance, mais elles peuvent y être traitées en juízo local cível simplifié pour les petits litiges. Par ailleurs, le Portugal a adopté la procédure européenne des petits litiges pour les créances transfrontalières < 5000 €, comme toute l’UE.
Juridictions spécialisées : Il existe des Tribunais do Trabalho (tribunaux du travail) pour les conflits employeur-salarié, des Tribunais de Família e Menores pour le droit de la famille et protection des mineurs, et des Tribunais de Comércio pour certaines affaires commerciales (faillites notamment). Ceux-ci sont généralement structurés comme des sections spécialisées au sein des Comarcas les plus importantes. En France, on retrouve une spécialisation similaire : conseil de prud’hommes pour le travail, tribunal de commerce, juge aux affaires familiales, etc., sauf qu’au Portugal les juges ne sont pas des conseillers non professionnels (sauf au tribunal de commerce où il y a parfois des juges consulaires), ce sont majoritairement des magistrats de carrière.
Procédures, avocats et accès à la justice
Accès à la justice : Les frais de justice au Portugal sont relativement modérés. Il n’y a pas de système de dépens exorbitants. Il faut s’acquitter d’une taxe de justice au dépôt d’une action (qui dépend de l’enjeu du litige, quelques dizaines à quelques centaines d’euros). En cas de succès, on peut récupérer une partie des frais. Si vos revenus sont modestes, vous pouvez solliciter l’apoio judiciário (aide judiciaire). Cette aide juridique portugaise, similaire à l’aide juridictionnelle en France, peut couvrir les frais d’avocat et de justice si vous remplissez les critères de ressources, que vous soyez portugais ou étranger résidant légalementcomparaja.pt. La demande d’aide judiciaire se fait auprès de la Sécurité Sociale portugaise justica.gov.pt. Les étrangers ressortissants de l’UE (donc les Français) y ont droit dans les mêmes conditions que les nationaux.
Avocats (advogados) : L’organisation de la profession d’avocat est comparable. L’Ordre des avocats (Ordem dos Advogados) régule l’accès et la déontologie. Il y a moins d’avocats par habitant qu’en France, mais à Lisbonne ou Porto on trouve de grands cabinets, dont certains à dimension internationale. Si vous ne parlez pas bien portugais, sachez qu’il existe des avocats francophones au barreau de Lisbonne ou d’Algarve – l’ambassade de France tient d’ailleurs une liste de contacts d’avocats parlant français.
Langue : La langue de la justice est le portugais. Toute pièce en langue étrangère présentée au tribunal doit être traduite officiellement (traduction assermentée). Si une partie ou un témoin ne comprend pas le portugais, un interprète doit être requis pour l’audience. Ceci est important pour les expatriés : prévoyez les frais de traduction/interprète si vous engagez un procès et que vous n’êtes pas à l’aise en portugais juridique.
Délais et efficacité : Il est connu que la justice portugaise peut être lente dans certains domaines (les affaires civiles complexes peuvent prendre plusieurs années en première instance, sans compter l’appel). Des efforts sont faits pour réduire les arriérés, notamment via la digitalisation (plateforme Citius pour les avocats, dépôts de pièces en ligne). En comparaison, la justice française souffre aussi de lenteurs notables selon les tribunaux. Dans les deux pays, des modes alternatifs de règlement des litiges se développent : médiation (mediação) et arbitrage. Le Portugal encourage la médiation familiale et la médiation des petits litiges de consommation via des centres d’arbitrage de conflits de consommation.
Exécution des jugements : Un jugement portugais, une fois définitif, peut s’exécuter par l’intermédiaire d’un agent d’exécution (agente de execução), équivalent de l’huissier de justice. Il n’y a pas de différence fondamentale par rapport à la France dans les procédures de saisie, d’expulsion locative, etc., si ce n’est qu’au Portugal l’agent d’exécution est souvent un avocat ou solicitador habilité, pas un officier ministériel indépendant comme l’huissier français.
En conclusion, un justiciable francophone trouvera au Portugal une justice au fonctionnement globalement similaire à celle de la France sur le plan des principes, avec ses qualités (indépendance, garantie des droits) et ses défauts (délais, formalisme). La principale barrière sera la langue et la connaissance des spécificités locales, d’où l’intérêt de se faire assister de professionnels compétents. En cas de litige franco-portugais, les mécanismes européens (Règlements Bruxelles I sur la compétence, règlements sur la coopération judiciaire) facilitent aussi la reconnaissance mutuelle des jugements entre nos deux pays.
Conclusion. De la vie familiale à l’entrepreneuriat, en passant par la fiscalité ou le droit du travail, le Portugal offre aux expatriés francophones un cadre juridique familier tout en réservant quelques surprises. Les similitudes avec le droit français, héritées du droit civil, rendent la transition plus aisée : un contrat, un mariage, un procès obéissent à des logiques comparables. Les différences – régime matrimonial fixe, absence d’impôts sur les successions, durée du travail de 40h, etc. – peuvent jouer en faveur d’une installation réussie lorsqu’elles sont bien comprises. En tant qu’expatrié, il est recommandé de se renseigner auprès de sources officielles portugaises (par exemple le portail législatif Diário da República montepio.orgmontepio.org ou les sites gouvernementaux) et de consulter des professionnels locaux (avocats, notaires, comptables) pour adapter votre situation au droit portugais. Armé de ce guide comparatif, vous voilà mieux préparé à naviguer dans le paysage juridique lusitanien en toute confiance, que ce soit pour profiter d’une retraite paisible en Algarve ou pour lancer la start-up qui vous tient à cœur à Lisbonne. Bonne installation – boa sorte !










