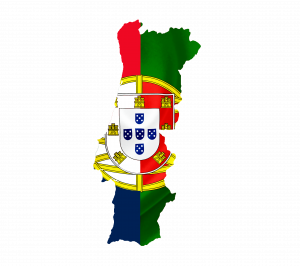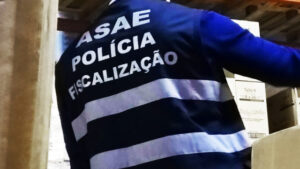« La musique cap-verdienne a un sentiment douloureux. Pourquoi ? Parce que c’est dans nos musiques que nous exprimons ce que la bouche ne dit pas, ce que la main n’écrit pas. La colère muette, le dégoût muet, le désespoir muet, les paroles de foi qui n’ont jamais été dites et les confessions qui meurent dans la gorge », écrivait Djunga di Biluca, fondateur de Morabeza Records, décédé en 2023.
Ces mots apparaissent sur la contre-couverture du premier disque qu’il aurait lancé en 1965, intitulé ‘Caboverdianos na Holanda’, où figuraient, entre autres, Franque Cavaquinho et Tazinho.
La Morabeza, qui a commencé par s’appeler Casa Silva, a été créée par Djunga di Biluca, qui faisait partie d’un premier groupe de dix travailleurs maritimes cap-verdiens arrivés dans les années 1950 à Rotterdam, où il s’est enraciné.
Ils seraient les premiers d’une communauté qui grandirait, avec l’homme de la Morabeza aidant ceux qui arrivaient à Rotterdam à trouver du travail, en plus d’être le représentant du PAIGC (Parti Africain pour l’Indépendance de la Guinée et du Cap-Vert), dont le leader, Amílcar Cabral, lui a confié la tâche de créer la maison de disques.
« La Morabeza était un projet politique. J’ai parlé avec Djunga di Biluca et il m’a dit que la maison de disques était une suggestion du propre Amílcar Cabral », a déclaré à Lusa le sociologue et spécialiste de la musique cap-verdienne César Monteiro, se rappelant que le leader du PAIGC avait « la conscience que la musique serait un instrument de résistance ».
Pour César Monteiro, la maison de disques était « l’expression des revendications identitaires du peuple cap-verdien », dont le projet politique et culturel était bien supérieur à tout objectif commercial ou lucratif.
Bien que la discographie de la Morabeza comprenne peu de disques aux musiques ouvertement contestataires, il y avait documentation et promotion de la musique cap-verdienne sans interférence de tiers, en contraste avec la vision du régime colonial portugais, qui rangeait toute expression artistique des colonies dans la catégorie du folklore.
« Beaucoup de musiques n’étaient pas chantées, elles étaient pincées à la guitare, mais ces musiques faisaient partie de notre identité. Dans ces musiques, il y a un sentiment évocateur d’une nostalgie, de cette nostalgie qui caractérise tout cap-verdien », a souligné César Monteiro.
C’est grâce à la création de la Morabeza que Bana, qui possédait déjà un club à Dakar, au Sénégal, est parti pour les Pays-Bas.
À l’invitation de Franque de Cavaquinho, il emporte ce qui serait l’embryon de La Voix du Cap-Vert, projet qui a connu différentes formations et configurations en près de 20 ans d’activité, que ce soit en tant que groupe en nom propre, ou en support pour beaucoup des grands noms de la musique cap-verdienne.
Selon le sociologue, Djunga di Biluca, en plus de la maison de disques, établissait aussi le lien entre les cap-verdiens qui arrivaient là et la mobilisation pour la lutte, à Conakry, où le PAIGC était installé et coordonnait la guerre de libération.
Lorsque Emanuel Varela a préparé son exil depuis le Portugal, par le biais du PCP, il a passé 15 jours à mémoriser « environ 100 numéros de téléphone » de maisons en France, Belgique et Pays-Bas. L’un d’eux était celui de Djunga di Biluca, raconte lui-même à Lusa, se souvenant d’un homme qui aidait tous les cap-verdiens arrivant à Rotterdam.
Le voyage devait ensuite le mener à la lutte à Conakry, mais il est resté à Rotterdam, en exil, se souvenant que rien que le symbole de la Morabeza pouvait créer des problèmes avec la PIDE, « qui savait que c’était un projet politique ».
« Djunga était toujours en première ligne », affirme le cap-verdien de 74 ans.
Déjà installé aux Pays-Bas, Emanuel Varela se souvient aussi du lien avec Bonga, qui sortira son premier disque par Morabeza, « Angola 72 ».
« C’était lors d’une fête en 1972, la veille du match Benfica contre le Feyenoord [de Rotterdam]. J’ai vu là Barceló de Carvalho [Bonga], le sportif, jouer. Il m’a dit qu’il voulait rester aux Pays-Bas et m’a demandé comment devenir exilé. Je lui ai expliqué et il n’est pas retourné au Portugal avec la délégation. Cette nuit-là, il a dormi dans ma chambre », se souvient-il.
Réalisant que Bonga chantait « et enchantait », il lui a présenté Djunga di Biluca et la Morabeza.
Avec le musicien angolais Mário Rui Silva et le cap-verdien Humbertona, il sortirait encore cette année-là le premier album d’une des plus grandes figures de la musique angolaise.
À cette époque, sous le label de la Morabeza, avaient déjà été édités des noms comme Luís Morais, Bana, Djosinha ou une alors inconnue Cesária Évora, avec un single, quarante ans avant de projeter la musique cap-verdienne dans le monde.
Parmi les disques enregistrés, se trouvent aussi les éditions de deux vinyles de ‘Protesto e Luta’ – l’un centré sur la musique et l’autre sur la poésie nationaliste cap-verdienne.
César Monteiro désigne ces deux œuvres comme « des disques qui marquent le plus cette période ».
António Lima, diplomate cap-verdien à la retraite qui est parti étudier en France au milieu des années 1960, se souvient des disques de la Morabeza comme « un motif de fierté et de courage pour la diaspora ».
« Entendre la voix de Bana et ses mornas et coladeiras ainsi que celles des autres apportait un sentiment d’affirmation, de fierté. C’était notre musique et c’était une chose belle, belle, belle », confie à Lusa António Lima, qui en France prend conscience politique et créé avec famille et amis le groupe Kaoguiamo, qui sortira un album avec le label du PAIGC avant l’indépendance.
On y trouve la musique ‘Amílcar Cabral’, qui n’est ni une morna, ni une coladeira, ni un funaná.
« C’est plutôt un cri », dit-il.
Selon António Lima, la musique lui est venue après la mort de Cabral, alors qu’il travaillait comme portier d’un immeuble à Paris.
À la question de Lénine « Que faire ? », António Lima a décidé d’écrire la chanson qui dit qu’Amílcar Cabral est mort « trop tôt », à un moment où il pensait que la lutte s’éteindrait avec la mort du leader du PAIGC.
Après le 25 avril, César Monteiro se souvient que ce disque de Kaoguiamo mobilisait les jeunes pour les nombreux meetings précédant le 5 juillet 1975, le jour de l’indépendance.
Mais la liberté, raconte-t-il, s’est aussi faite au son des cordes de la guitare de Humbertona, éditée par Morabeza, qui envahissait les radios après la chute de l’État Nouveau.
António Lima se souvient bien de ce premier disque de Humbertona, ‘Lágrimas e Dor’, de 1967.
« Vous savez, la beauté inspire aussi la révolte. Une personne se demandait pourquoi une musique aussi extraordinairement belle ne pouvait être entendue. Pourquoi devait-elle être réduite au silence ? Ainsi, cette musique apportait des interrogations, elle apportait des larmes et de la saudade », dit-il.
Dans un documentaire d’une télévision hollandaise, Djunga di Biluca déclarait que la Morabeza montrait que les cap-verdiens avaient une culture propre et que le label servait à préserver et maintenir cette même culture et identité.
« Sans culture et sans identité, tu n’es rien », dit-il.