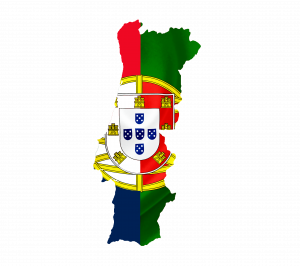« Dans le cadre de la compensation des restrictions d’accès physique au terrain, l’IFCN évalue et teste actuellement l’utilisation de ‘boules de semences’ avec des espèces adaptées aux conditions écologiques locales, une solution visant à faciliter la récupération des zones inaccessibles », indique l’institut régional dans une note envoyée à l’agence Lusa.
L’incendie, qui a brûlé pendant 13 jours consécutifs à Madère, a parcouru une superficie de 5 116 hectares, dans les communes de Ribeira Brava, Ponta do Sol, Câmara de Lobos (dans la zone ouest) et Santana (sur la côte nord), dont environ 84 % de la surface brûlée possède des pentes égales ou supérieures à 50 %, situées sur des pentes raides et des zones très difficiles d’accès.
Le recours aux drones dans le processus de restauration écologique est également évalué par les autorités régionales, mais « nécessite une étude préalable pour sélectionner les meilleures semences à cet effet ».
Les ‘boules de semences’, préparées avec des substrats protecteurs et des mélanges spécifiques de semences indigènes, pourraient ainsi être lancées dans des zones difficiles ou inaccessibles.
« Cette approche s’inscrit dans un plan intégré de restauration écologique, adapté aux particularités géomorphologiques de la région, favorisant la récupération de l’écosystème avec une perturbation minimale du sol et de la biodiversité existante », précise l’IFCN.
À la suite de l’incendie de l’année dernière, l’IFCN a élaboré un « plan de stabilisation d’urgence », intervenant immédiatement dans une zone présentant « une plus grande sensibilité », sur une superficie d’environ cinq hectares, avec l’enlèvement de la végétation carbonisée, l’installation de barrières physiques et la plantation d’espèces, tout en élaborant des projets d’intervention et de restauration écologique à moyen et long terme qui sont en cours d’évaluation dans le cadre des mécanismes de financement européen.
Ces projets, évalués à environ 1,4 million d’euros, prévoient l’introduction de 170 000 plantes.
L’incendie de 2024 a consumé 139 hectares de forêt de laurisilva, qui est un patrimoine mondial et occupe un total de 15 000 hectares, et a menacé les nids de la puffin du Cap-Vert, un oiseau marin en danger d’extinction, qui niche dans les montagnes entre le Pico do Areeiro et le Pico Ruivo.
L’IFCN assure que les nids n’ont pas été détruits et explique que les 139 hectares de forêt de laurisilva font partie du réseau Natura 2000 et sont situés dans des zones d’accès difficile.
« Face à ce scénario, connaissant la gravité de l’incendie et reconnaissant la capacité de régénération des espèces, l’IFCN a choisi de maintenir une stratégie de surveillance active et continue de ces zones, permettant d’évaluer l’évolution naturelle de la végétation afin de pouvoir élaborer une stratégie à moyen/long terme pour appliquer des mesures complémentaires pouvant accélérer la récupération », a-t-il expliqué.
L’incendie rural de 2024 a éclaté le 14 août dans les montagnes de la commune de Ribeira Brava, dans la zone ouest de Madère, se propageant progressivement aux municipalités de Câmara de Lobos, Ponta do Sol et Santana. Le 26, après 13 jours, le Service Régional de Protection Civile a indiqué que l’incendie rural était « totalement éteint ».
Aucun blessé ou destruction de maisons et d’infrastructures publiques essentielles n’a été enregistré, et la zone brûlée était principalement composée de broussailles, de forêts et de petites exploitations agricoles, environ 200 agriculteurs et 41 éleveurs ayant déclaré des pertes.
La situation ayant le plus d’impact a été le déplacement de 120 habitants de Fajã das Galinhas, un endroit reculé dans les hautes zones de la commune de Câmara de Lobos, en raison des flammes qui ont encerclé la zone, rendant impraticable l’unique route d’accès sur environ deux kilomètres le long d’un escarpement.
Un an après, selon les autorités, l’escarpement reste « instable et dangereux pour la circulation des personnes », et les habitants sont toujours en situation de relogement provisoire.
La lutte contre l’incendie a mobilisé plus de mille intervenants des corps de pompiers de la région, en système de rotation, ainsi que des membres de la Force Opérationnelle Conjointe (FOCON) et des pompiers volontaires des Açores, soutenus par 268 véhicules et trois moyens aériens : l’hélicoptère permanent et deux avions Canadair, activés via le Mécanisme Européen de Protection Civile, qui ont réalisé 26 décharges entre les 22 et 23 août.
L’incendie a conduit à la constitution d’une commission d’enquête à l’Assemblée Législative de Madère, à la demande du PS, alors le plus grand parti de l’opposition régionale, avec l’objectif de déterminer les responsabilités politiques dans la gestion de la lutte contre l’incendie, au sein de laquelle divers organismes ont été entendus.
Les travaux ont cependant été interrompus en janvier 2025 suite à la chute du gouvernement régional minoritaire du PSD et n’ont jamais été repris, les sociaux-démocrates ayant ensuite remporté les élections anticipées du 23 mars et formé un gouvernement en coalition avec le CDS-PP.