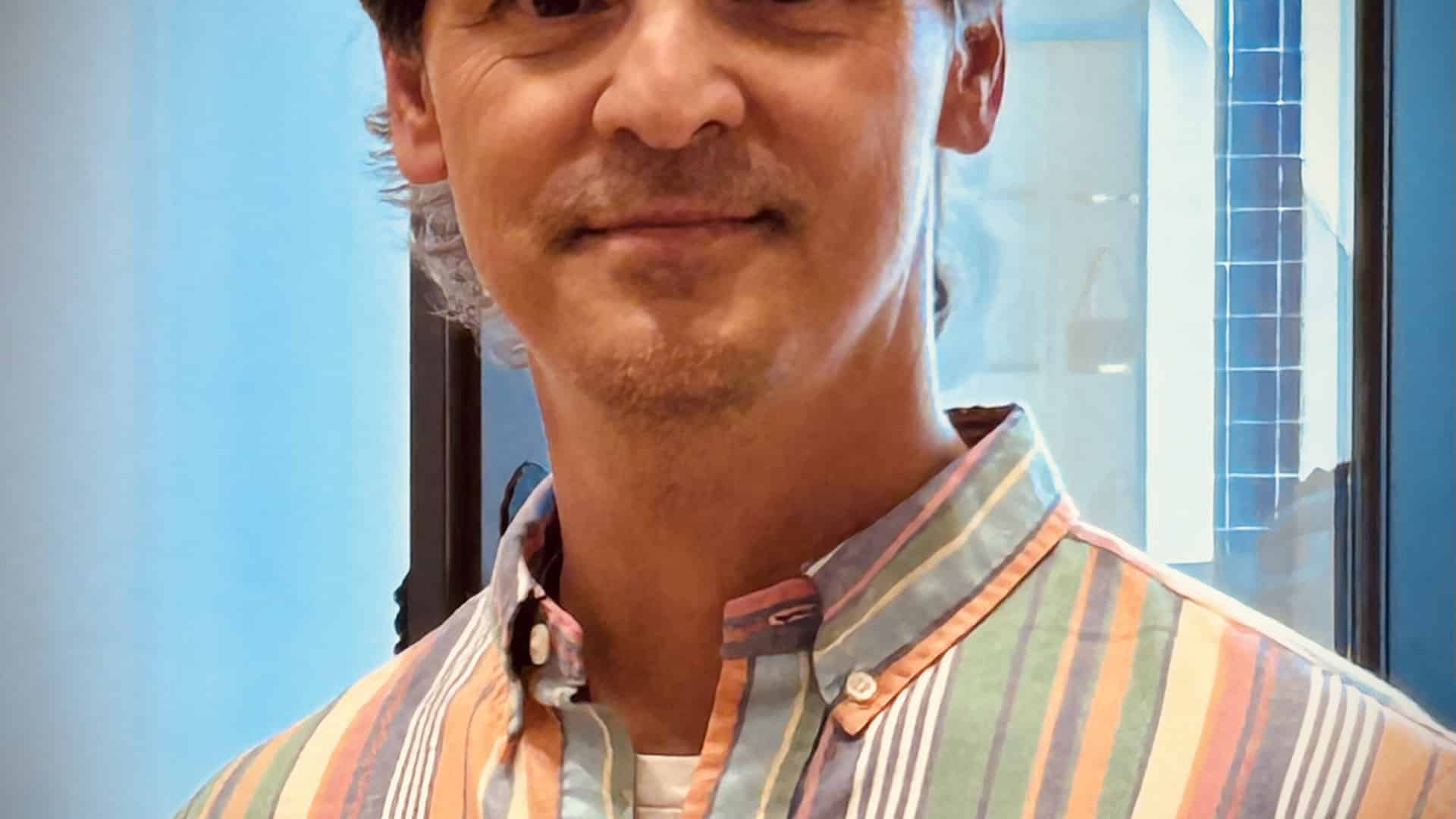La décision historique du Parlement portugais de qualifier le viol de crime public représente une étape cruciale dans la protection des victimes et la poursuite de la justice. Cette décision, qui implique des modifications des codes pénal et de procédure pénale, dépasse la simple formalité légale, promettant un impact profond sur la manière dont la société en général, et le système judiciaire en particulier, traitent ce crime odieux.
Le viol était un crime semi-public, nécessitant une plainte de la victime pour que l’enquête soit poursuivie. Cette « barrière juridique », souvent insurmontable en raison du traumatisme, du stigmate et de la peur, aboutissait à de nombreux cas non dénoncés et, par conséquent, sans justice. La transition vers un crime public signifie que la dénonciation peut être faite par toute personne et l’enquête peut être lancée par les autorités, même sans plainte formelle de la victime. Ce changement est un pas fondamental pour garantir que la voix des victimes soit entendue même lorsque les victimes elles-mêmes ne peuvent pas parler.
Bien que ce changement soit fondamentalement positif, il n’est pas exempt de contraintes pour la victime, notamment en ce qui concerne les conséquences néfastes d’une éventuelle exposition forcée de l’expérience traumatique et intime. Il existe diverses variables à considérer que seul le temps et la mise en œuvre effective de la loi permettront d’évaluer et d’adapter le système au mieux pour la protection des victimes. Donner la parole à la victime et respecter son droit au silence est un équilibre difficile à gérer.
Dans les arguments en faveur, le passage au crime public signifie la possibilité pour le ministère public de pouvoir engager une enquête sans plainte de la victime, ce qui peut contribuer à réduire l’impunité des agresseurs, afin que plus d’agresseurs puissent être condamnés et davantage de victimes protégées.
Dans les arguments défavorables, cette modification peut entraîner de fausses accusations et augmenter le risque de re-traumatisation, avec perte de la liberté de décision pour la victime. La décision d’engager ou de poursuivre une procédure judiciaire peut être prise par des tiers, y compris les autorités, indépendamment de la volonté expresse de la victime. Être forcée de participer à un processus légal, revivre le traumatisme, fournir des témoignages répétés et être soumise à un examen intense peut aggraver l’état de santé mentale, prolonger la souffrance et compliquer le processus de rétablissement psychologique.
La pratique clinique avec les victimes de viol a contribué à approfondir la connaissance psychologique dans ce domaine particulier. Il est devenu consensuel que le contrôle sur le récit des événements et le temps nécessaire pour traiter le traumatisme sont cruciaux pour le rétablissement psychologique de la victime. L’affaire bien connue « Casa Pia » en est un exemple. Le suivi et l’étude des victimes dans ce cadre ont contribué, sans équivoque, à comprendre l’importance et la nécessité d’allonger les délais de prescription des plaintes. La victime a besoin de temps pour guérir et ce temps est hautement subjectif – c’est le temps de chaque personne et de son histoire unique. L’imposition d’un processus peut être perçue par la victime comme une invasion de sa vie privée et de son bien-être, et contribuer à l’amplification du traumatisme. La discussion scientifique et le regard technique vigilant sur ce sujet se feront certainement sentir à l’avenir. De nombreux défis nous attendent.
Le viol est un crime qui porte atteinte à la liberté sexuelle de toute personne, quel que soit son genre. La violence sexuelle n’a ni visage, ni sexe, ni âge, ni orientation sexuelle. La « protection » désormais accordée s’adresse à toutes les victimes, qu’il s’agisse d’hommes, de femmes, d’enfants ou de personnes de toute identité de genre, consolidant un principe d’égalité et de portée dans la défense des droits humains.
Dans ce nouveau paradigme, la psychologie légale assume une importance encore plus cruciale dans les processus judiciaires de viol. Son intervention n’est pas simplement un complément, mais un pilier essentiel pour la compréhension des faits, l’évaluation de l’impact psychologique sur les victimes et l’assistance au tribunal dans la prise de décision.
Évaluation de la crédibilité et de la cohérence du témoignage : Le traumatisme du viol peut affecter la mémoire et la capacité à raconter les événements de manière linéaire. La formation spécifique et l’entraînement des psychologues légistes permettent de comprendre ces dynamiques, de distinguer les incohérences causées par le traumatisme des tentatives de fabrication, et d’aider le tribunal à contextualiser le témoignage de la victime, renforçant ou affaiblissant sa crédibilité.
Identification et atténuation de l’impact psychologique : Le viol laisse des cicatrices profondes. L’évaluation psychologique légale permet de documenter l’impact psychopathologique, tel que le stress post-traumatique, la dépression, l’anxiété, l’isolement social et d’autres troubles, qui non seulement valident l’expérience de la victime, mais peuvent également influencer les décisions sur la réparation des dommages. De plus, la présence d’un psychologue légiste peut aider à atténuer la re-traumatisation pendant le processus judiciaire, créant un environnement plus sûr pour la victime.
Analyse comportementale et profil psychologique : La psychologie légale aide à l’analyse comportementale de l’agresseur, contribuant à l’élaboration de profils qui peuvent être utiles dans l’enquête et la compréhension des modèles de comportement.
Pour les victimes particulièrement vulnérables, comme les enfants ou les personnes handicapées intellectuelles, le rôle du psychologue légiste est encore plus crucial. Ces professionnels possèdent les compétences pour conduire des entretiens judiciaires adaptés, garantissant que le témoignage soit obtenu de manière non suggestive et minimisant le traumatisme.
Dans un scénario où la voix de la victime est parfois réduite au silence par le traumatisme ou la pression du système, l’expertise indépendante en psychologie légale émerge comme un élément de clarté et d’équité procédurale, soit par des évaluations psychologiques légales réalisées de manière initiale, soit par des avis techniques et scientifiques documentaires sur les pièces déjà existantes dans le processus.
L’expertise indépendante en psychologie légale offre une vision technique et scientifique impartiale essentielle pour les avocats, procureurs/magistrats du ministère public et juges, qui ne possèdent pas toujours des connaissances approfondies sur la dynamique du traumatisme et ses réflexes sur le comportement et le récit des victimes. Une évaluation d’expertise indépendante peut, par exemple, corroborer ou remettre en question la cohérence d’un témoignage à la lumière des connaissances scientifiques actuelles sur l’
événement traumatique, ou encore, fournir une analyse détaillée du profil psychologique de l’agresseur et/ou de la victime.
Les avis documentaires permettent, par exemple, une analyse critique et scientifique des rapports déjà produits dans le cadre du processus, identifiant les lacunes et/ou les incohérences, toujours fondées sur la science psychologique et la pratique clinique et judiciaire. La combinaison de l’examen d’expertise psychologique et l’évaluation documentaire assure que tous les angles du profil psychologique et comportemental pertinents soient dûment explorés et présentés, informant et aidant à la réalisation de la justice.
La transition du viol en crime public est une victoire pour la justice et pour les victimes. Cependant, le succès de cette mesure dépendra, dans une large mesure, de la manière dont le système judiciaire intègre les outils et les connaissances que les sciences médico-légales, en particulier la psychologie légale, ont à offrir, sans négliger la nécessité de sauvegarder l’autonomie et le bien-être psychologique de la victime.
C’est un moment d’espoir et de renouveau de l’engagement en faveur des droits humains. Que ce changement soit un catalyseur pour une société plus juste et protectrice, où la quête de justice soit toujours équilibrée par un profond respect pour la dignité et l’autonomie de chaque victime.
La recherche de la vérité dans la réalisation de la justice est un pilier fondamental pour tout citoyen. Dans ce contexte, l’accès à des instruments permettant cette recherche, comme la possibilité d’un deuxième avis technique et scientifique indépendant, est un droit inaliénable pour chacun. Garantir que chaque individu a les moyens de contester, corroborer ou approfondir les preuves est essentiel pour l’équité et la confiance dans le système judiciaire. »
* article écrit sous l’ancien accord orthographique.