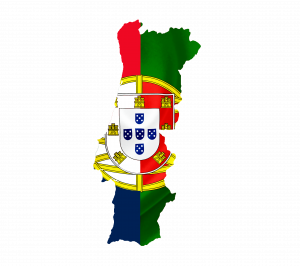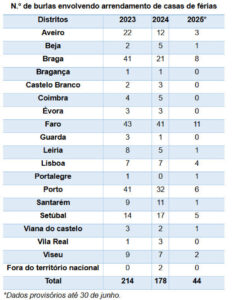Pour la professeure de l’Université du Minho, le problème réside dans l’absence d’avis obligatoires dans le processus d’approbation et les limitations à l’accès à la justice mentionnées dans les modifications du « régime juridique d’entrée, de séjour, de sortie et d’éloignement des étrangers du territoire national ».
« Du point de vue procédural, il y a eu des irrégularités » dans l’approbation parlementaire du texte de loi, en raison du fait « qu’aucun avis obligatoire n’a été demandé », explique Patrícia Jerónimo, dans des déclarations à Lusa.
En question, les avis du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) et du Conseil Supérieur des Tribunaux Administratifs et Fiscaux (CSTAF), demandés avec un délai de seulement deux jours, mais également l’absence d’audition des constitutionnalistes et des associations d’immigrants, formellement requise par les partis d’opposition.
Les organes ont déjà informé le parlement qu’ils n’étaient pas en mesure de rendre un avis juridique en un temps si restreint.
De plus, la nouvelle loi réduit le droit de recours aux tribunaux pour ceux qui reçoivent des décisions administratives de la part de l’AIMA, ce qui peut faire encourir au texte de loi une « violation du droit d’accès à la justice », alerte la chercheuse, avec une thèse sur les migrations et la citoyenneté au Portugal, dans l’Union Européenne et en lusophonie.
« Ne pas pouvoir recourir aux tribunaux pour une décision de regroupement familial est hautement problématique », parce que, selon la loi générale, « les décisions administratives sont toujours susceptibles de recours devant les tribunaux », considère la professeure, spécialiste des migrations.
Aujourd’hui, les politiciens ont l’illusion de pouvoir créer une forteresse en Europe, mais « les choses sont plus complexes », car les « routes migratoires ne s’arrêtent pas, elles se détournent », mais la « pression va persister et le pays a besoin de main-d’œuvre ».
Dans le passé, « le Portugal était dans une certaine mesure protégé de la pression migratoire car il y avait d’autres destinations plus attrayantes du point de vue géographique et financier ».
À la fin des années 1990 et au début des années 2000, le Portugal a connu une première vague migratoire, venant de l’Europe de l’Est et de pays hors de l’espace lusophone, ce qui a été vu par de nombreux Portugais, « presque fièrement », comme un signe que le pays « était entré dans le club des riches » et était attractif du point de vue des immigrants économiques.
La présence de ces immigrants a généré, pour la première fois, la discussion sur l’intégration des étrangers, conduisant à des politiques publiques basées essentiellement sur l’enseignement de la langue portugaise.
Alors, « le Portugal semblait être un pays hautement inclusif » et cela « correspondait à une certaine idée de pays accueillant, multiculturel et tolérant », ce qui a changé au cours des dernières années lorsque les pays d’origine des immigrants ont changé.
« Nous avons commencé à avoir également une vague de sentiment anti-étranger et les réponses juridiques suivent cette ligne » : les dirigeants de parti « ont repris l’idée qu’il est politiquement utile de diaboliser les immigrants », a-t-elle estimé.
Malgré tout, au Portugal, la majorité des politiciens « ont encore des préoccupations dans le discours et montrent une certaine patine d’humanité » envers les immigrants, affirmant que cet durcissement des lois vise à créer une « société cohésive et intégrée ».
Les changements des règles du regroupement familial, repoussant de deux ans les demandes après l’attribution des autorisations de résidence, sont un signe de ce changement d’attitude de l’État portugais.
La « directive européenne établit des limites pour le regroupement familial » et le Portugal offrait la solution la plus favorable aux demandeurs dans ces limites, parce qu' »il n’y a rien de mal à ce que l’immigrant puisse amener sa famille nucléaire » à ses côtés.
« Maintenant, on opte pour une solution qui laisse les immigrants vivre seuls et cela engendrera des coûts d’intégration », a déclaré la juriste, estimant qu' »il était préférable d’avoir des familles » et non des individus isolés.
Cela exige des ressources de la part de l’État, avec des investissements dans les services publics, car la « responsabilité ne peut pas être uniquement mise sur les immigrants », a défendu Patrícia Jerónimo, rappelant que la Commission européenne elle-même insiste sur le fait que l’intégration est un processus bidirectionnel, qui requiert des efforts tant des immigrants que de la société d’accueil.
L’une des critiques envers le texte examiné par Marcelo Rebelo de Sousa est la fin du traitement préférentiel envers les immigrants de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP).
« Le débat parlementaire était intéressant : les partis à droite sont ceux qui défendent le plus traditionnellement la lusophonie » et ce sont eux qui ont approuvé « ce recul que nous avons maintenant », puisque « l’accès au territoire portugais devient plus difficile ».
Désormais, tous les visas de travail doivent être émis depuis les pays d’origine et toute personne entrant avec un autre type de visa ne peut pas changer de statut sur le territoire portugais.
Cependant, la juriste indique que ce changement ne remet pas en cause l’accord de mobilité de l’organisation, car c’est un traité qui « permet une grande latitude aux États » dans la façon dont ils le mettent en œuvre.
« Le Portugal était à l’avant-garde et semblait très engagé dans la promotion de l’accord, et maintenant il recule sur les droits qu’il avait inscrits dans la loi sous cet accord », a-t-elle estimé, tout en admettant que le traité « n’est pas une contrainte juridique pour l’État portugais ».