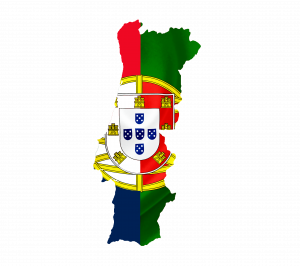Le statut de travailleur-étudiant est prévu par la loi, avec des droits et devoirs, et permet une certaine flexibilité en termes de travail.
Ce statut, rappelle DECO PROteste, s’applique à tout niveau d’enseignement, « y compris les cours de troisième cycle, de master ou de doctorat », ainsi qu’à ceux qui suivent « un cours de formation professionnelle ou un programme d’occupation temporaire de jeunes d’une durée minimale de six mois. »
« Le statut spécial s’applique également aux travailleurs salariés et aux travailleurs indépendants », détaillent-ils dans un article partagé sur leur site.
Pour que ce soit bien clair, voici quatre questions-réponses sur le sujet :
Comment demander le statut ?
Pour demander ce statut, il est nécessaire d’obtenir un document de l’établissement d’enseignement attestant l’inscription et l’emploi du temps, et à la fin de l’année, il faut également démontrer qu’il y a eu réussite.
À l’établissement scolaire, il faut attester « votre situation de travailleur, par exemple, par une déclaration de l’employeur et une preuve d’inscription à la Sécurité sociale. »
Et comment perd-on ce statut ?
Pour conserver le statut de travailleur-étudiant, il doit y avoir « réussite dans au moins la moitié des matières ». Sinon, l’année suivante, les « droits relatifs à l’emploi du temps, aux vacances et aux congés » seront perdus.
« Les autres droits prennent fin en cas d’échec deux années consécutives ou trois années non consécutives. Sauf si la raison est un congé parental, une adoption d’une durée minimum d’un mois, un risque pendant la grossesse ou une maladie prolongée, un accident de travail ou une maladie professionnelle », précisent-ils, en ajoutant que la perte de statut n’est pas irréversible. « Mais cela ne peut se produire que deux fois », préviennent-ils.
Quels sont certains des droits ?
Concernant les droits, ils incluent la possibilité pour le travailleur-étudiant de « s’absenter deux jours pour un examen, un test écrit ou oral ou pour présenter un travail : les deux jours correspondent au jour de l’épreuve et à la veille, week-ends et jours fériés inclus. »
« Si vous avez des examens plusieurs jours de suite ou plus d’une épreuve le même jour, vous pouvez être absent autant de jours avant qu’il y a d’évaluations. Au total, vous avez droit à quatre jours par année scolaire par matière », clarifient-ils.
Bien qu’il ne soit pas nécessaire d’obtenir l’autorisation de l’employeur pour s’absenter, l’étudiant doit informer celui-ci de son absence avec, au moins, cinq jours d’avance et fournir un justificatif de l’épreuve.
« Vous pouvez également demander jusqu’à dix jours de congé non rémunéré par an, consécutifs ou non. Les délais d’avis diffèrent selon les cas : 48 heures si vous souhaitez un jour; huit jours si vous prenez entre deux et cinq jours; et 15 jours si le congé dépasse cinq jours », ajoutent-ils.
« Un emploi du temps compatible avec les obligations professionnelles doit être choisi », écrivent encore les spécialistes, avançant que l’entreprise doit toutefois adapter le planning à la vie scolaire. « Si cela n’est pas possible, elle est obligée de vous libérer jusqu’à six heures par semaine pour assister aux cours, selon le nombre d’heures de travail. Ceux qui travaillent entre 20 et 29 heures par semaine ont droit à trois heures; entre 30 et 33 heures, jusqu’à quatre heures; entre 34 et 37 heures, jusqu’à cinq heures; et 38 heures ou plus, jusqu’à six heures. L’entreprise peut exiger la preuve de la fréquentation des cours », illustrent-ils.
Et si c’est par roulements ?
Dans le cas de roulements, le travailleur-étudiant a un droit de préférence dans le choix de son horaire de travail, afin de suivre les cours. « En règle générale, des heures supplémentaires ne peuvent être exigées d’un travailleur-étudiant. Mais, si l’entreprise parvient à justifier que, pour des raisons de force majeure, elle a besoin de plus de main-d’œuvre, elle peut le faire », déclarent-ils encore, soulignant que « chaque fois qu’il effectue un travail supplémentaire, il a droit à un temps de repos correspondant à la moitié des heures de travail supplémentaires. »