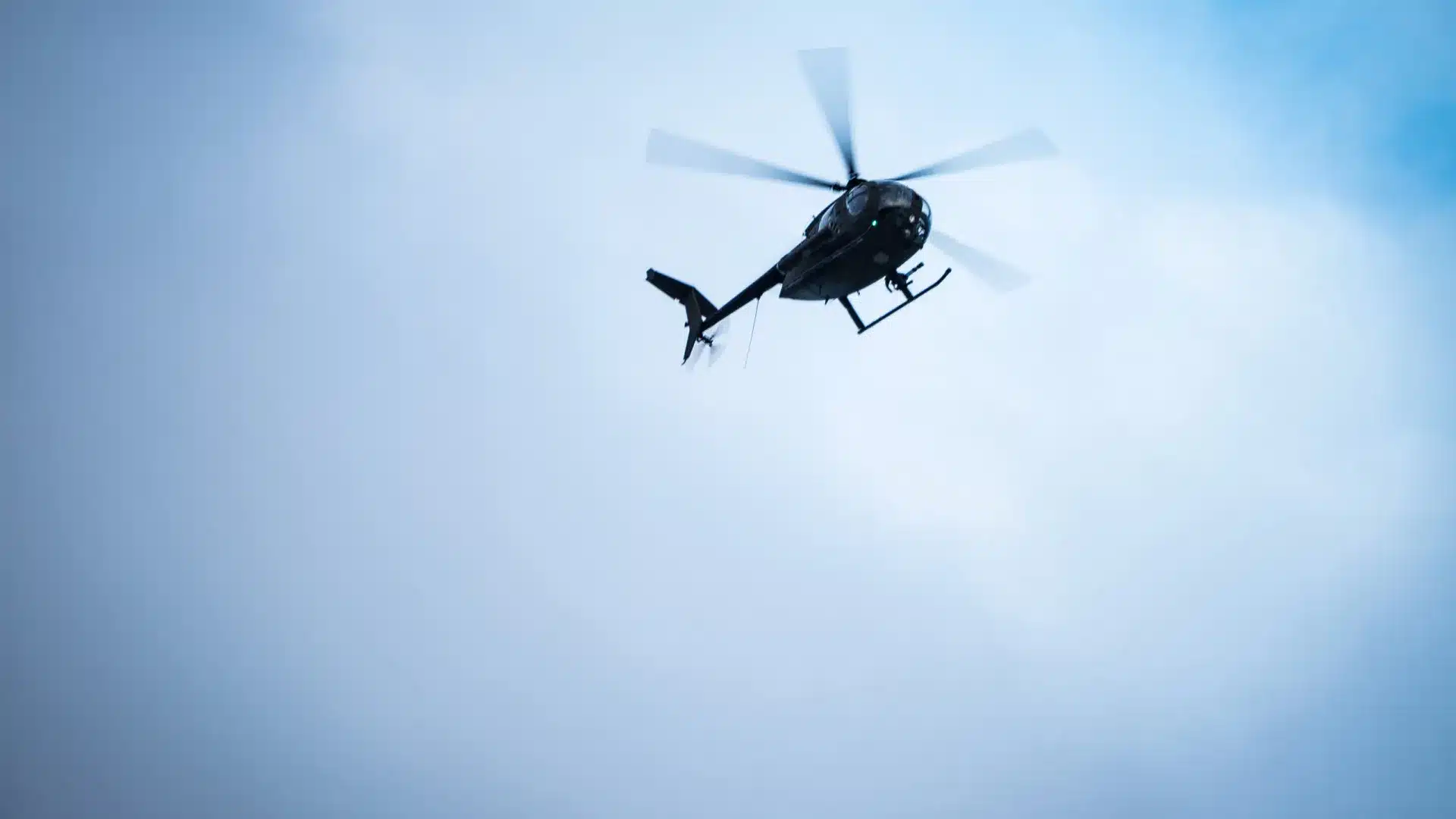Les recommandations figurent dans le rapport final du Bureau de Prévention et d’Investigation d’Accidents avec Aéronefs et d’Accidents Ferroviaires (GPIAAF), auquel Lusa a eu accès aujourd’hui, concernant l’accident d’un hélicoptère de lutte contre les incendies survenu le 30 août dans la région de Cambres, Lamego, dans le district de Viseu, au cours duquel cinq militaires de la GNR/Unité d’Urgence de Protection et Secours (UEPS) ont perdu la vie.
« Cet accident, ainsi que le contexte réglementaire de l’activité de lutte aérienne contre les incendies et le nombre d’événements de sécurité aboutissant à des décès enregistrés annuellement, montrent qu’il y a besoin et possibilité pour une révision urgente du règlement n.º 641/2022 », souligne le GPIAAF.
En ce sens, « et parce que des lacunes ont encore une fois été identifiées dans le contenu des formations des pilotes engagés dans la lutte contre les incendies, qui auraient été pertinentes pour éviter l’accident », l’enquête a réitéré une recommandation faite en juillet 2023 à l’Autorité Nationale de l’Aviation Civile (ANAC), régulateur du secteur.
Le GPIAAF recommande que l’ANAC « ajuste et détaille les exigences de formation des pilotes impliqués dans les activités de lutte contre les incendies, en particulier dans les principes généraux et transversaux des facteurs humains ».
L’enquête suggère que cette révision ne se limite pas seulement à des aspects tels que « la perte de conscience situationnelle, la vision en tunnel, l’excès de motivation, la gestion des pressions externes et les concepts de CRM [Gestion des Ressources de l’Équipage], afin de garantir que cette conformité résultera en un niveau acceptable de performance de sécurité opérationnelle ».
« Comme largement débattu dans les rapports d’investigation d’événements similaires, l’implémentation et la validation des exigences de formation des équipages, notamment dans les aspects des facteurs humains, doivent être urgemment revues », avertit le GPIAAF.
Cette organisation souligne qu' »un suivi et une évaluation de l’implémentation pratique des exigences, des difficultés des opérateurs, ainsi qu’une supervision du type, détail et efficacité de la formation fournie aux pilotes par les opérateurs, sont nécessaires ».
En 2015, le GPIAAF a émis une recommandation de sécurité à l’ANAC pour que les « équipes impliquées dans des opérations au-dessus de l’eau, notamment les pilotes d’hélicoptères et d’avions amphibiens, commencent à utiliser des gilets de sauvetage ».
Une décennie après, « cette recommandation reste sans réponse utile » de la part du régulateur national.
Concernant la normalisation des déviations par rapport aux trajectoires, l’acceptation généralisée parmi les concernés et l’absence de supervision par les différentes entités, facteurs considérés contributifs à l’accident, le rapport indique que l’Armée de l’Air a pris des mesures pour superviser les vols, déclarant que, « face à de telles déviations et en cas de doute », par l’intermédiaire du Bureau de Coordination de la Mission dans le cadre des Incendies Ruraux, « elle sollicitera des informations supplémentaires aux opérateurs respectifs ».
Le GPIAAF a également émis trois recommandations de sécurité à l’opérateur de l’hélicoptère accidenté : « qu’il réévalue le système de gestion de la sécurité, pour implémenter un système de collecte et de traitement des données de vol, agissant sur les déviations identifiées ; qu’il réalise une analyse de risque de l’opération et détermine les équipements de sécurité minimaux à bord », et « qu’il établisse un programme de formation détaillé sur les aspects des facteurs humains et de gestion de CRM pour ses opérationnels ».
Dans le même domaine des facteurs humains, il y a également une recommandation à la GNR/UEPS pour qu’elle, en collaboration avec les opérateurs et l’ANAC, établisse un programme de formation pour ses opérationnels « en adaptant le concept de spécialistes de mission prévu par l’EASA », régulateur européen du secteur de l’aviation.