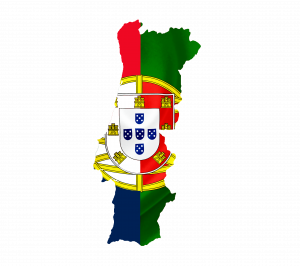« Il est nécessaire de cesser de romantiser ce qu’était la colonisation et cela ne doit pas se limiter aux expositions ou conférences », soutient le commissaire, avec André Cunha, de l’exposition collective ‘Balumuka! – Narrativa poética da liberação… ou ainda, Rebelião Poética Kaluanda’, présentée au Centre d’Arts de Sines dans le cadre du Festival Músicas do Mundo (FMM).
« Le processus de décolonisation ne doit pas être réalisé uniquement d’un seul côté, par les Angolais », souligne Kiluanji Kia Henda, ressentant qu’au Portugal, il manque encore une ouverture pour débattre du sujet, comme il l’affirme.
« La décolonisation ne se limite pas à hisser des drapeaux ou à composer des hymnes », note-t-il, défendant « la célébration de la mémoire dans l’espace public ».
C’est dans ce but que sera construit le Mémorial en hommage aux Personnes Asservies, qui sera installé dans la zone de Ribeira das Naus, à Lisbonne, dont Kiluanji Kia Henda est l’auteur.
Le processus de construction du mémorial – un projet de l’Association des Afro-descendants (Djass) approuvé dans le budget participatif municipal de 2017/2018 – traîne depuis cinq ans, étant actuellement en phase d’adaptation du projet, sur un plan artistique et budgétaire, mais Kiluanji reste confiant en sa réalisation.
Le retard – observe l’artiste visuel – est dû, en partie, à « un public qui ne comprend pas l’importance » du mémorial et qui préfère ignorer que le Portugal fut responsable de « presque la moitié » des personnes « trafiquées depuis l’Afrique » et que les Portugais « furent les premiers à commencer [l’esclavage] et les derniers à le terminer ».
En regardant l’Angola, un demi-siècle après l’indépendance, Kiluanji Kia Henda voit « un pays qui a encore beaucoup de défis devant lui (…), qui, malheureusement, n’a pas encore trouvé de stabilité ».
« C’est un pays avec une histoire très violente » et qui a besoin de « changements plus effectifs », considère-t-il, fier de la jeunesse angolaise actuelle, « qui a de la force, qui veut changer, qui ne se contente pas d’une histoire » qui l’a « également soumise à un certain silence ».
Cette jeunesse lui donne « un certain espoir » et Kiluanji trouve aujourd’hui dans la communauté artistique « un langage beaucoup plus ouvert, beaucoup plus contestataire », qui « peut mener à un chemin de changement ».
‘Balumuka! — Narrativa poética da liberação…ou ainda, Rebelião Poética Kaluanda’, qui réunit des œuvres d’artistes établis et d’autres plus jeunes, peut être visitée jusqu’au 15 octobre. C’est un regard sur la musique en tant que vecteur de préservation de l’histoire et l’importance qu’elle a eue durant la libération coloniale, la guerre civile et également la paix.
« On peut faire une lecture de la société, en regardant ce qui a été produit par les musiciens », souligne le commissaire, rappelant que « beaucoup de choses » ont déjà disparu et qu’il existe « un grand problème concernant la question de la préservation de la mémoire en Angola ».
Cependant, certains documentaires offrent « un panorama assez profond de certaines périodes de l’histoire en Angola » et ont donc été inclus dans l’exposition, qui couvre la période chronologique de 1960 à 2025.
Cinq films sont présentés, de 1978 à 2018 : ‘Carnaval da Vitória’, d’António Ole, ‘Mopiópio’, de Zézé Gamboa, ‘É Dreda Ser Angolano’, de Pedro Coquenão + Luaty Beirão, ‘Luanda — A Fábrica da Música’, de Kiluanje Liberdade et Inês Gonçalves, et ‘Para Lá dos Meus Passos’, de Kamy Lara.
Le projet multidisciplinaire rassemble les artistes Cassiano Bamba, Pedro Coquenão et Luaty Beirão, Zezé Gamboa, Kiluanje Liberdade et Inês Gonçalves, Kiluanji Kia Henda, Kamy Lara, Wyssolela Moreira, António Ole et Gegé M’bakudi et Resem Verkron.
De Kiluanji Kia Henda, deux séries sont exposées (‘Versus Carnaval’ et ‘O Som é o Monumento’), accompagnées de deux œuvres commandées de Wyssolela Moreira et Resem Verkron & Gegé M’bakudi, en dialogue avec les archives de la maison de disques Valentim de Carvalho, et la série de photographies ‘Luandar’, images inédites de la vie nocturne des jeunes à Luanda, par Cassiano Bamba.