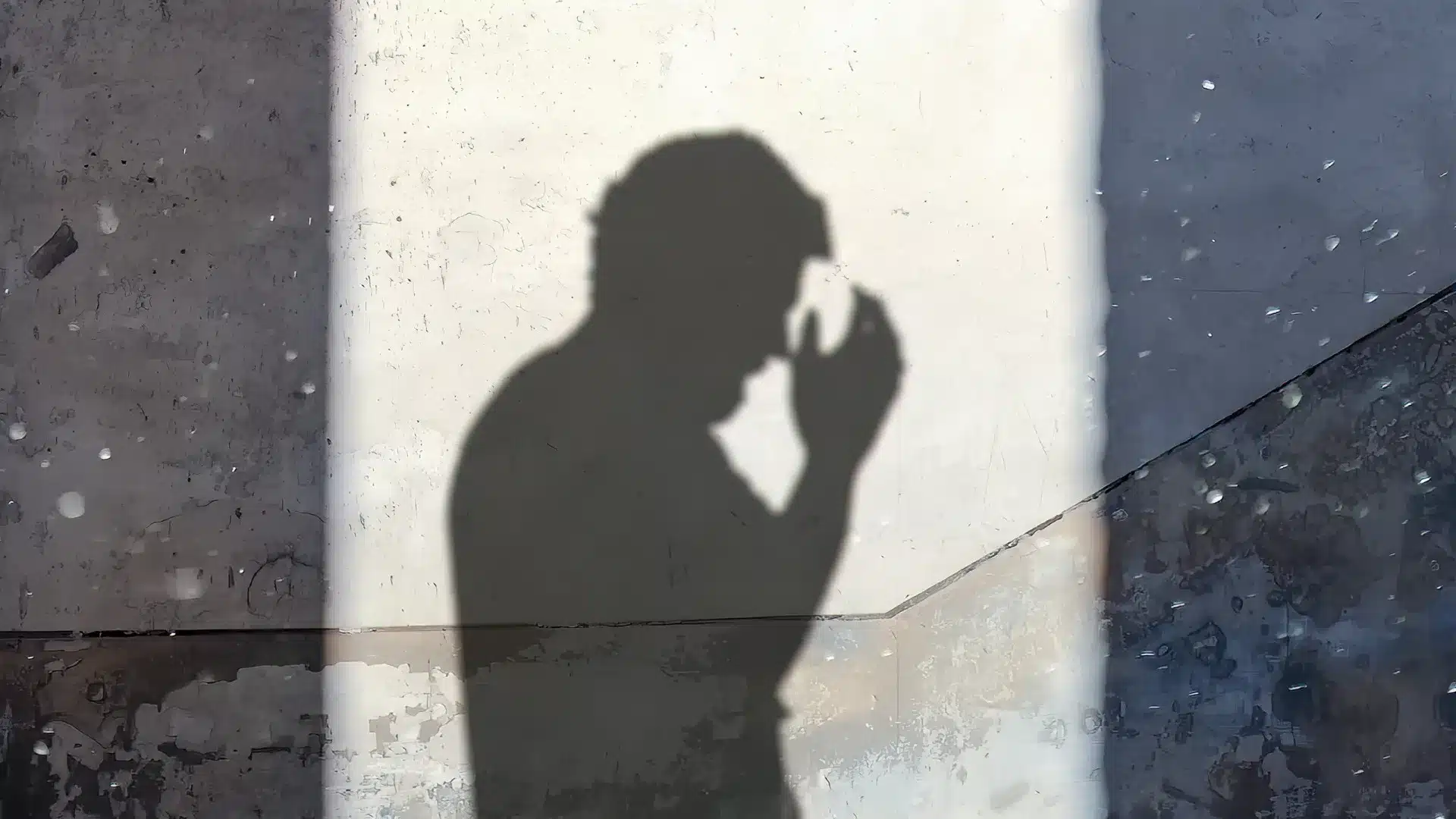António était un simple et respecté agriculteur quand des hallucinations ont commencé à le hanter, le rendant violent. Il entendait des voix, pensait que ses poules étaient possédées par le diable. Il a agressé sa belle-mère et sa femme et, finalement, tué son patron, persuadé d’être trahi.
Lors du procès, il a été prouvé qu’il n’était pas conscient de son crime, comme le rappelait l’hebdomadaire Expresso en 2015. Il souffrait de schizophrénie paranoïde. Il a donc été jugé pénalement irresponsable et interné à l’hôpital Miguel Lombarda à Lisbonne, qui a fermé ses portes en 2011, avant d’être transféré au pavillon de psychiatrie légale de Júlio de Matos, aujourd’hui Centre Hospitalier Psychiatrique de Lisbonne.
Au total, António a passé près de 60 ans interné, soit plus du double de la peine maximale prévue par la loi au Portugal. Et il n’a pas été le seul.
Lorsque la nouvelle loi sur la santé mentale est entrée en vigueur en août 2023, 46 personnes ont été identifiées comme devant être libérées car elles étaient internées depuis plus longtemps que le délai admissible.
Certaines avaient réellement commis des crimes, comme António. D’autres non. Toutes se trouvaient dans une sorte de perpétuité, dans un pays qui a aboli cette peine il y a déjà près de 140 ans, en 1884.
C’est précisément l’une des grandes modifications que la nouvelle loi portugaise sur la Santé Mentale a apportée. L’extension automatique des internements involontaires, auparavant qualifiés de « compulsifs », a été abolie. Désormais, ils doivent être réexaminés tous les deux mois et ont pour seul objectif de traiter ceux qui en ont besoin (et peuvent être traités), sans jamais « éliminer » ceux dont la société persiste à avoir honte plutôt que de les accueillir.
La nouvelle Loi sur la Santé Mentale (Loi n° 35/2023) revêt ainsi un caractère plus protecteur et de rigueur légale et clinique. Le texte s’appuie sur la Convention relative aux droits des personnes handicapées, le Plan de santé mentale approuvé par l’Organisation mondiale de la santé, les lignes d’action stratégique pour la santé mentale et le bien-être de l’Union européenne ainsi que sur les recommandations du Comité de bioéthique du Conseil de l’Europe.
Mais cette nouvelle loi est-elle appliquée dans son intégralité ? Dispose-t-on des moyens nécessaires pour cela ? En pratique, qu’est-ce qui a déjà changé ? Notícias ao Minuto a tenté de comprendre en s’adressant au président de la Commission pour le Suivi de l’Exécution du Régime Juridique du Traitement Involontaire (CAERjTI), Fernando Vieira, et à la psychiatre légiste Susana Pinto Almeida.
Différences entre types d’internement
Il est avant tout important de distinguer les types d’internement en matière de santé mentale existant au Portugal, qui sont au nombre de trois :
- Volontaire – lorsque le patient accepte l’internement, reconnaissant sa nécessité de traitement ;
- Involontaire (anciennement appelé compulsif) – réalisé contre la volonté du patient, lorsqu’il représente un danger pour lui-même ou pour autrui et n’a pas la capacité de donner son consentement ;
- Internement des irresponsables pénalement – individus présentant une anomalie psychique ayant commis des crimes, mais qui, en raison de leur incapacité à évaluer l’illégalité de leur acte, ne peuvent être tenus pénalement responsables, bien qu’ils puissent représenter un danger pour la société.
15.180 internements psychiatriques en 2024, dont 4.109 involontaires
Selon le Notícias ao Minuto, Fernando Vieira, président de la Commission pour le Suivi de l’Exécution du Régime Juridique du Traitement Involontaire (CAERjTI) et psychiatre à l’ancien hôpital Júlio de Matos, aujourd’hui Centre Hospitalier Psychiatrique de Lisbonne, a indiqué que le nombre d’internements psychiatriques, en particulier involontaires, a diminué en 2024 par rapport à 2023, bien que « légèrement ».
« En ce qui concerne le nombre d’internements psychiatriques, alors qu’en 2023 nous comptions 16.852, en 2024 nous en comptons 15.180. Cela pour l’ensemble des internements. Si l’on ne parle que des internements involontaires – sachant que jusqu’à août 2023 on parlait d’internements compulsifs et qu’à partir de là on parle d’internements involontaires – je peux aussi dire que le nombre a légèrement diminué. En 2023, nous avions 4.351 internements involontaires, en 2024 nous avons 4.109 », révèle-t-il.
Ce qui peut signifier que les gens sont plus conscients des défis posés par les maladies mentales et choisissent volontairement de se faire hospitaliser, mais cela peut aussi signifier d’autres choses, souligne le médecin. « Cela peut signifier, par exemple, que la loi est effectivement appliquée. Autrement dit, que seules les personnes présentant les tableaux cliniques les plus graves sont internées », ou, alors, quelque chose de moins positif : « si des évaluations plus rapides sont réalisées. » Et ne pas obtenir les diagnostics corrects.
Les dilemmes éthiques des internements involontaires
L’internement involontaire, sujet de ce rapport, est l’une des mesures les plus sensibles et exceptionnelles prévues par la législation portugaise. Elle implique la privation de liberté d’une personne pour garantir son traitement et faire en sorte qu’elle ne mette pas sa propre vie ou celle des autres en danger, ce qui met en « conflit des valeurs fondamentales », comme le souligne auprès de Notícias ao Minuto, la psychiatre légiste Susana Pinto Almeida.
« Les traitements involontaires en santé mentale posent des défis éthico-légaux profonds, car ils impliquent d’intervenir dans l’un des noyaux les plus sensibles de la vie humaine : la liberté individuelle et l’autodétermination. Ici se confrontent des valeurs fondamentales, l’autonomie personnelle versus le devoir de soin, la protection des droits individuels versus la responsabilité de prévenir des dommages graves à la personne elle-même ou, dans certains cas, à autrui », indique la spécialiste de l’Institut National de Médecine Légale et des Sciences Forensiques.
Le premier grand dilemme éthique est précisément celui de l’autonomie : « traiter quelqu’un contre sa volonté exige de reconnaître qu’à ce moment-là, la personne n’a pas la capacité de décider de manière consciente et informée sur sa propre santé ». Et cette suspension de la volonté n’est éthiquement légitime que si elle est cliniquement bien fondée, basée sur des critères techniques rigoureux et appliquée avec proportionnalité face au risque identifié ».
Pour Susana Pinto Almeida, il est donc nécessaire de s’assurer que, « dans de telles situations, ce n’est pas la dignité de la personne qui est suspendue, mais uniquement, de manière temporaire et justifiée, sa capacité formelle à consentir, toujours dans le but de la restaurer le plus rapidement possible ».
La nouvelle loi relative à la santé mentale établit que le danger « doit être sérieux, actuel et identifiable, comprenant non seulement un risque physique, mais aussi un risque de dégradation marquée de la santé ».
Le défi éthique consiste donc à « garantir que cette évaluation n’est pas fondée sur des jugements moraux ou des préjugés, mais sur des critères cliniques rigoureux, décrits de manière claire, humaine et bien fondée ».
Un autre point sensible est le consentement. « Si le patient n’a pas la lucidité, sa volonté exprimée ne peut être suivie », rappelle la médecin. Cependant, même dans ces cas, « la dignité de la personne doit être protégée, en lui fournissant des informations, en l’écoutant, en impliquant une personne de confiance et en préparant le retour progressif à la décision autonome dès que possible ».
« La contrainte, quand elle est inévitable, doit être minimale, proportionnelle et justifiée ; elle ne doit jamais être banalisée », souligne-t-elle.
Du point de vue éthique, il est également exigé que, s’il est imposé un internement, « cela représente une véritable opportunité thérapeutique, avec des conditions adéquates, un accompagnement digne et le respect du quotidien du patient ».
« Forcer quelqu’un à se soigner dans un endroit déshumanisé ou sans réponse clinique réelle serait, éthiquement, une double violation : on prive de liberté sans garantir l’avantage », souligne la spécialiste qui offre son soutien à l’Hôpital Prisional São João de Deus.
Enfin, le devoir de communiquer les données cliniques au tribunal sans consentement, bien qu’encadré légalement, impose également des précautions éthiques : « On doit partager seulement ce qui est strictement nécessaire, avec pondération et respect pour la vie privée ».
En résumé, comme le souligne la spécialiste, « le traitement involontaire ne peut être considéré que comme un acte autorisé par la loi, il doit être construit éthiquement ».
Le véritable défi est donc, maintenant, « d’équilibrer le devoir de soin avec le respect de l’autonomie, garantissant que, même sans consentement, l’on agisse avec humanité, prudence et proportionnalité, au cas par cas ».
Le processus décisionnel
Au Portugal, la décision d’interner quelqu’un contre sa volonté n’est pas prise par un seul médecin ou un membre de la famille. C’est un processus qui implique plus d’un professionnel de la santé et culmine toujours par la confirmation d’un juge, basée sur une évaluation clinique et psychiatrique rigoureuse.
Il y a d’abord une évaluation médicale initiale. Les médecins psychiatres analysent si le patient remplit trois conditions légales cumulatives : maladie mentale grave (qui affecte le discernement et le comportement) ; refus, de la part du patient, du traitement médical nécessaire à sa condition ; et la présence d’une situation de danger grave (pour les biens juridiques importants) en résultant de cette maladie.
Si ces critères sont réunis, les médecins élaborent un rapport motivé et l’envoient au tribunal. Enfin, la décision judiciaire est prise.
En somme, comme l’explique Susana Pinto Almeida au Notícias ao Minuto, « le mot final revient à un juge, mais seulement après la confirmation médicale que l’internement involontaire est (cliniquement) justifié ».
Évaluation du risque. « Danger n’est pas synonyme de coup, couteau ou crime »
L’évaluation du danger, dans le contexte du traitement involontaire, est réalisée par des médecins psychiatres sur la base de l’observation clinique, des récits de tiers (familles, soignants, autorités) et du savoir technique et scientifique sur les symptômes psychopathologiques et l’évolution de la maladie mentale.
Cependant, comme le souligne la psychologue légiste, il est important de clarifier que, dans la nouvelle Loi sur la Santé Mentale, « le danger n’est pas synonyme de coup, couteau ou crime ».
« Danger signifie un risque sérieux, actuel et identifiable de lésion de biens juridiques pertinents, et la santé (physique et mentale) est l’un de ces biens. Réduire le danger simplement aux agressions ou comportements illicites, c’est dé médicaliser la propre nature des symptômes psychiatriques et ignorer ce qui est cliniquement en jeu », explique-t-elle, rappelant que celui-ci peut mettre en danger autrui autant que le patient lui-même (suicide, automutilation ou détérioration grave de la santé).
Dans le cas où le risque concerne la personne elle-même, une condition essentielle s’ajoute pour que celle-ci puisse être internée involontairement : « attester que le patient n’a pas le discernement nécessaire pour évaluer sa situation et consentir aux soins dont il a besoin ».
Le risque peut se manifester, par exemple, par une conduite imprudente motivée par des idées délirantes, un refus alimentaire sévère à risque de malnutrition, un comportement désorganisé avec une manipulation dangereuse du gaz ou de l’électricité, des hallucinations auditives avec des ordres suicidaires ou violents, des fuites à domicile, de la déambulation, une exposition au froid ou au danger, ainsi qu’une négligence extrême de la santé physique (refus d’insuline, de transfusions ou de traitements vitaux), motivée par des croyances psychotiques.
Ces exemples, comme le note Susana Pinto Almeida, « n’impliquent pas de violence, mais représentent un danger réel et actuel : danger d’effondrement physique, de détérioration mentale irréversible, de perte de capacité décisionnelle, de désintégration sociale ».
« Premièrement, on perd l’autocritique. Ensuite, la capacité de décider avec clarté »
« C’est dans ces cas que les professionnels doivent reconnaître le dommage clinique progressif comme forme de danger : quand la maladie ronge progressivement la pensée, le jugement et l’autodétermination de la personne. Premièrement, on perd l’autocritique. Puis, on perd la capacité de décider avec clarté. En fin de compte, on perd la propre liberté réelle de choix, car sans discernement, il n’y a pas de véritable autonomie. L’évaluation du risque, donc, ne s’épuise pas dans les signes d’agressivité », estime la spécialiste, rappelant que cela peut se produire même sans un « incident violent ».
L’internement devrait être vu, selon la nouvelle loi, comme une mesure de protection pour rétablir la capacité décisionnelle du patient, empêchant la maladie de continuer à dégrader la santé, le comportement ou la capacité fonctionnelle de la personne.
« La loi est claire à ce sujet, à la fois du point de vue juridique et clinique : s’il y a maladie mentale, si le patient refuse le traitement nécessaire et s’il existe un danger concret alors un traitement peut être imposé. En principe, en ambulatoire. L’internement est la dernière ressource et pour le temps minimal indispensable », réitère Susana Pinto Almeida, soulignant que ce type d’action ne devrait pas être vu comme une « punition ».
« C’est une garantie de droits. C’est traiter pour protéger la santé, rétablir la capacité de décision et éviter que l’histoire évolue vers des issues tragiques, comme la judiciarisation, le contexte criminel ou l’institutionnalisation prolongée », observe-t-elle.
La psychiatre rappelle encore que « quand le système n’agit que tardivement, en réaction et non en prévention, on perd le bon moment pour intervenir cliniquement et le dommage s’aggrave ». L’idéal est donc « de traiter tôt, dans le milieu le moins restrictif possible, dans le but de redonner au patient ce que la maladie lui a enlevé : la liberté de décider en pleine conscience ».
Évidemment, bien que « l’évaluation du danger dépende d’un jugement clinique subjectif », ce qui, selon Susana Pinto Almeida, « exige une formation continue et un soutien éthique et décisionnel aux équipes. ».
De la crise à la sortie d’hôpital
Le processus d’internement involontaire commence de manière urgente ou planifiée. La voie urgente, selon la psychiatre, est la plus courante et est déclenchée par un « événement critique », par exemple une tentative de suicide, un comportement violent, un épisode psychotique aigu.
Quelqu’un appelle les services d’urgence (INEM) ou la police et les autorités emmènent immédiatement la personne au service d’urgence psychiatrique. Le patient est évalué par le psychiatre de garde qui décide s’il y a nécessité d’un internement involontaire. Si oui, l’usager est temporairement privé de sa liberté, dans une unité psychiatrique, et l’hôpital en informe le juge ce jour même. À partir de là, le tribunal dispose de 48 heures pour organiser l’audience initiale et confirmer si l’internement est maintenu.
Si les conditions pour le maintenir ne sont pas réunies, le patient est immédiatement libéré. En revanche, si cela est nécessaire, deux autres psychiatres procèdent à une évaluation détaillée du patient et préparent un rapport final pour le tribunal.
Via l’itinéraire planifié, il n’y a pas « nécessairement d’urgence en cours, mais on perçoit que la personne est en déclin dangereux », ce qui peut se produire, par exemple, quand un patient ne se présente plus aux consultations ou que la famille signale qu’il a abandonné son traitement et qu’il est « de plus en plus mal et désorienté ».
Dans ces cas, un membre de la famille, le médecin, le ministère public (MP) ou une autorité sanitaire dépose une demande au tribunal. Le juge analyse si les conditions légales sont remplies et, si tel est le cas, détermine les prochaines étapes (nomination de deux psychiatres et fixation de la date pour l’audience).
Le juge ordonne une évaluation en ambulatoire et le patient peut être convoqué à se présenter à l’hôpital tel jour pour être évalué par deux psychiatres. Ceux-ci élaborent un rapport détaillé pour le juge conformément au délai légal, jusqu’à 15 jours.
À partir de là, le processus est similaire dans les deux cas. Le juge organise une audience où il écoute le patient, l’avocat, les membres de la famille et les médecins et décide de décréter le traitement involontaire (internement ou ambulatoire) ou de clôturer le processus.
Le traitement peut alors se poursuivre, commencer ou être conclu. S’il continue, le processus est réexaminé périodiquement, tous les deux mois, se terminant dès que les raisons qui ont motivé le traitement cessent d’exister, soit par décision judiciaire, soit par congé médical ratifié par le juge.
Dans le cadre de l’internement involontaire, le patient reste dans l’unité hospitalière, reçoit des médicaments, des soins médicaux et commence sa convalescence. Dans le traitement ambulatoire involontaire, le patient est suivi régulièrement au sein de la communauté (équipe de santé mentale supervisant, pouvant même faire des visites à domicile, s’assurant qu’il prend ses médicaments, par exemple).
Susana Pinto Almeida clarifie également que la loi exige que au moins deux psychiatres effectuent l’évaluation et à chaque révision périodique, deux autres rédigent de nouveaux rapports, garantissant ainsi, « un second regard clinique » sur la situation, évitant « des décisions précipitées » et favorisant « des décisions mieux fondées ».
« En somme, la décision est collégiale dans le cadre médical et ensuite complétée par l’autorité judiciaire. Elle ne dépend pas d’une opinion singulière. Elle requiert le consensus médical d’au moins deux spécialistes et l’homologation du juge », résume la psychiatre.
L’objectif est de ne pas prolonger outre mesure un internement coercitif. « La loi et les professionnels le considèrent comme une mesure temporaire et exceptionnelle. Dès que le patient recouvre suffisamment de discernement et de stabilité, il doit passer à un régime moins restrictif ou sortir de l’internement », affirme Susana Pinto Almeida, ajoutant que cette révision sert à « éviter que quelqu’un soit oublié à l’hôpital indéfiniment ».
En plus de ces révisions bimestrielles obligatoires, à tout moment, une révision peut être demandée si de nouveaux motifs apparaissent. Par exemple, « le médecin responsable peut informer le tribunal que le patient a considérablement amélioré et suggérer la fin de l’internement, ou le patient lui-même (ou la famille) peut, par l’intermédiaire de son avocat, demander une réévaluation en présentant des arguments selon lesquels les critères ne sont plus remplis ».
« Une perpétuité dissimulée »
Sur le plan juridique, il n’existe pas d’internements à vie. Pourtant, on a tenté d’éliminer tous les scénarios de « prison à perpétuité déguisée » qui se sont accumulés au fil de plusieurs (trop nombreuses) décennies.
« La nouvelle loi est venue renforcer cela en modifiant la législation connexe, comme le Code pénal, pour prévenir les internements (d’irresponsables pénalement), de durée illimitée. La constitution prohibait déjà la privation de liberté à perpétuité. Ce qui pouvait se produire, surtout dans le cadre forensique (irresponsables pénalement internés pour dangerosité), étaient des renouvellements successifs qui, en pratique, laissaient les individus internés pendant des décennies. Maintenant cela a été freiné, avec la loi 35/2023 modifiant la législation connexe, déterminant qu’aucune mesure de sécurité d’internement ne dépasse la peine maximale du crime commis dans le cadre pénal, et 46 personnes ont été identifiées comme devant être libérées car elles étaient internées depuis plus longtemps que le délai admissible », explique Susana Pinto Almeida.
Dans le contexte civil (internements involontaires de patients non auteurs de crime), la durée tend à varier de quelques jours à quelques mois, en fonction de l’évolution clinique. Bien qu’il y ait, « malheureusement, des cas de patients très graves et sans soutien familial qui finissent par rester internés de longues périodes car on n’arrive pas à les intégrer à l’extérieur ».
Mais, même ceux-là ne restent pas « oubliés », garantit la psychiatre. Tous les deux mois, le cas est réexaminé, et s’ils restent internés, « c’est parce que les critères de dangerosité et d’incapacité persistent ». Ainsi, « personne ne restera interné à vie, par imposition légale et éthique ». Tout internement involontaire doit cesser dès qu’il n’est plus nécessaire et doit être révisé fréquemment pour le garantir.
Fernando Vieira souligne également cela : « Le paradigme a changé. Aujourd’hui, nous savons que cela ne fonctionne pas. Même une personne ayant la tuberculose : Elle va en consultation, se soigne et rentre chez elle. Elle ne reste pas pour toujours dans un sanatorium. Évidemment, elle doit avoir des soins pour éviter les infections, mais c’est ainsi. Et en psychiatrie, c’est pareil. D’ailleurs, aujourd’hui, nous savons que les internements trop prolongés peuvent être plus préjudiciables ».
Maintenant, « nous ne pouvons pas tomber dans l’extrême opposé, dans les internements en porte-tambour, où la personne est libérée pour ensuite devoir être internée de nouveau ».
« Si la personne peut suivre un traitement à l’extérieur, tout en étant consultée, il n’est pas nécessaire de la retenir juste pour son traitement. On ne peut plus mettre quelqu’un dans un hôpital comme mesure coercitive, du type : elle va faire du mal à quelqu’un, alors elle reste ici cloîtrée », réitère-t-il.
« Nous ne pouvons plus interner les gens simplement parce qu’ils sont malades »
Fernando Vieira souligne cela même lorsqu’il est interrogé sur les principaux points de changement avec la nouvelle loi. « Je pense que ce qui a changé était ce qu’il fallait changer. Le changement de paradigme s’imposait face à la législation internationale, à la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Nous ne pouvons plus interner les gens simplement parce qu’ils sont malades. Les gens ne peuvent plus être vus comme des objets de charité – ce n’était déjà plus le cas – ni comme des objets de traitement. Les malades doivent être vus comme des sujets avec des droits et doivent être traités comme tels. Avant d’être malades, les malades mentaux sont des personnes », souligne-t-il, clarifiant qu' »un handicap, aussi grave soit-il, ne peut à lui seul justifier l’internement ».
« Fondamentalement, ce qui a changé avec la nouvelle loi était le critère de l’existence d’un danger, car si une personne constitue le danger et si le traitement est la meilleure façon d’éloigner ce danger, nous pouvons la priver de sa liberté. Tant que l’application du traitement diminue ce danger », note encore le psychiatre.
Puis, il y avait besoin de repenser toute l’organisation des traitements et des soins. « Dès lors, un traitement plus proche de la personne, plus proche de la résidence, une approche plus communautaire, avec un déplacement des équipes sur place. Il est évident que, vingt ans après l’ancienne loi sur la santé mentale, des avancées ont eu lieu au niveau scientifique, des avancées surtout au niveau social, au niveau de l’appréciation des droits des personnes, des droits humains, la reconnaissance elle-même, et donc, il y avait besoin de changements, même dans les traitements eux-mêmes », relève-t-il, donnant comme exemple l’évolution des médicaments.
« Avant, nous donnions aux gens des injectables restant en circulation pendant un mois, maintenant nous avons des médicaments pouvant rester en circulation pendant deux, trois mois. Certains restent jusqu’à six mois, ce qui favorise une meilleure adhésion au traitement », note-t-il.
« L’État a l’obligation de garantir le traitement »
Les internements involontaires se déroulent principalement dans les hôpitaux du Service National de Santé (SNS), notamment dans les unités d’hospitalisation en psychiatrie.
Au Portugal, chaque région dispose de services de psychiatrie et de santé mentale publics, certains intégrés dans des centres hospitaliers, d’autres dans des hôpitaux psychiatriques spécialisés.
C’est dans ces lieux que l’on trouve les conditions de sécurité, les équipes multidisciplinaires, des soins infirmiers 24 heures sur 24, des installations adéquates et la coopération directe avec les tribunaux nécessaire pour gérer ces cas.
Susana Almeida Pinto indique que « ces derniers temps, certains services d’hospitalisation en psychiatrie dans le secteur privé ont commencé à émerger, mais ils sont surtout pour des internements volontaires ». Néanmoins, souligne la psychiatre, c’est « à l’État qu’incombe l’obligation de garantir le traitement ».
Donc, typiquement, si quelqu’un est interné involontairement, il ira dans une aile de psychiatrie d’un hôpital psychiatrique traditionnel comme le Centre Hospitalier Psychiatrique de Lisbonne, ancien Júlio de Matos à Lisbonne, ou l’Hôpital Magalhães Lemos à Porto, ou dans l’aile en service de psychiatrie d’un hôpital du SNS, comme cela se passe pour les internements volontaires.
« Il n’y a pas de patients de première et de deuxième classe »
« Les internements involontaires sont la même chose que les internements volontaires. La seule chose qui les distingue est que, en l’absence de consentement, il devra être une autorité judiciaire qui donne le feu vert à cette privation de liberté. Il n’y a pas de patients de première ni de deuxième classe. Ces citoyens sont donc hospitalisés dans les services d’hospitalisation psychiatrique, aux côtés d’autres patients. Ils sont traités de la même manière », renforce auprès de Notícias ao Minuto le président de la CAERjTI, Fernando Vieira.
La routine d’un patient interné
Un internement psychiatrique involontaire, au quotidien, ressemble à un internement volontaire, hormis que le patient ne peut sortir sans autorisation médicale et qu’il y a un processus judiciaire en cours.
L’accompagnement clinique doit être assuré par une équipe multidisciplinaire composée de psychiatres, d’infirmiers en santé mentale, de psychologues, de thérapeutes occupationnels et d’assistants sociaux.
Le plan thérapeutique est adapté à l’évolution clinique et une attention particulière est accordée à la continuité des soins par la même équipe, autant que possible.
La routine quotidienne inclut des repas, l’administration de médicaments, des moments de repos et la participation à des activités thérapeutiques (groupes, ateliers, exercices, entre autres), ajustées à l’état de chaque personne.
Les salles offrent des espaces communs avec télévision, livres ou jeux, et, progressivement, les patients retrouvent des habitudes de vie.
L’accès au téléphone portable et à Internet sous supervision varie selon l’état clinique et les règles de chaque unité. « Les visites familiales sont autorisées, sauf exceptions cliniques, et fortement encouragées comme partie intégrante du processus de rétablissement », raconte à Notícias ao Minuto Susana Pinto Almeida.
À mesure que le patient stabilise, des sorties progressives sont autorisées, telles que des promenades accompagnées dans l’enceinte de l’hôpital ou des week-ends à la maison.
À l’approche de la sortie, l’accent est mis sur la réintégration et l’autonomie. « Même lors d’un internement involontaire, les droits fondamentaux sont préservés : le patient est informé, peut communiquer avec l’extérieur, participer aux décisions au fur et à mesure qu’il retrouve son discernement, et doit être traité avec respect et humanité. Il y a des restrictions, mais elles doivent être proportionnelles au risque et correctement surveillées. Il s’agit d’une période de stabilisation intensive et de protection, destinée à restaurer la santé et à préparer un retour sûr et digne à la communauté », souligne la psychiatre.
La schizophrénie, diagnostic le plus fréquent (mais pas le seul)
Les diagnostics des patients internés involontairement sont souvent des maladies mentales graves, chroniques ou aiguës, affectant le discernement et le comportement. Les plus courantes sont les psychoses et, en particulier, la schizophrénie.
« Des études de casistica au Portugal montrent que la schizophrénie est le diagnostic le plus fréquent lors des internements involontaires, dans certains échantillons, elle représentait environ la moitié des cas internés, suivie d’autres troubles psychotiques et du trouble bipolaire », explique la médecin.
Outre la schizophrénie, on distingue également le trouble bipolaire – notamment à sa phase maniaque, lorsque les patients deviennent euphoriques, sans notion des limites -, la dépression sévère avec risque suicidaire ou dépression psychotique, les troubles schizoaffectifs ou les psychoses aiguës (parfois liées au consommant de substances) et les démences ou états organiques avec symptômes psychiatriques sévères.
Bien que moins fréquent, il peut également y avoir des internements involontaires chez les patients borderline, ou antisociaux en crise suicidaire ou hétéro-agressive extrême.
Néanmoins, « la nouvelle loi rend l’internement involontaire dans ces cas plus difficile ». « Seulement si le risque de mort est élevé et que la personne n’a pas de discernement à ce moment-là, ce qui impliquera généralement un certain degré de changement de l’état mental, non justifié par la personnalité », souligne Susana Almeida Pinto.
« Consommation d’alcool et de drogues peut précipiter des crises et augmenter les dangers »
Il est également important de souligner que beaucoup de ces patients ont des diagnostics simultanés ou des « situations compliquées » comme, par exemple, la schizophrénie et la toxicomanie ou la bipolarité et l’alcoolisme.
« La consommation d’alcool et de drogues peut précipiter des crises et augmenter les dangers, et de nombreux internements se produisent chez des patients avec pathologie duale », c’est-à-dire une maladie mentale et une addiction, explique la psychiatre légiste.
Dans la plupart des cas, selon la spécialiste, beaucoup de patients internés involontairement avaient déjà « un diagnostic psychiatrique antérieur, étant déjà connus des services de santé mentale, qui pour une raison ou une autre ont interrompu le traitement ou se sont décompensés ».
Cependant, « une grande partie des internés involontairement n’effectuait pas de traitement pharmacologique au moment de l’admission, suggérant que beaucoup sont des cas d’abandon thérapeutique », comme cela se produit souvent dans les cas de schizophrénie.
Dans ces cas, observe Susana Almeida Santos, « la rechute tend à être plus sévère et la personne, sans conscience de la maladie, refuse de reprendre le traitement, culminant dans l’internement involontaire en dernière recours ».
« Malheureusement, certains patients ont une trajectoire de multiples décompensations : ils s’améliorent avec le traitement, sortent d’hôpital, mais après un certain temps, en raison de failles dans le suivi ou de manque d’adhésion, se dégradent à nouveau, ce qui nécessite un nouvel internement. Ainsi, de nombreux patients internés involontairement ont une histoire de maladie mentale de longue date », avertit-elle.
En revanche, certains patients font l’expérience de leur première crise ou premier épisode psychiatrique déjà d’une gravité telle qu’ils sont internés involontairement sans avoir été diagnostiqués auparavant. Ils sont moins fréquents proportionnellement, mais existent.
Beaucoup de ces premières crises se produisent à un jeune âge – la schizophrénie, par exemple, se manifeste souvent à la fin de l’adolescence ou au début de l’âge adulte – ou peuvent être des crises maniaques de personnes qui jusque-là ne savaient pas qu’elles souffraient de trouble bipolaire. Mais il y a aussi des situations précipitées par la consommation de drogues (telle que la psychose par cannabis ou amphétamines).
En résumé, pour également consultante en psychiatrie forensique, « l’internement involontaire est souvent un filet de sécurité utilisé lorsque le patient connu est sorti du réseau de soins et est entré en crise ».
« Le pire est de finir par être dévié vers le système judiciaire, après avoir commis un acte illicite, et de finir avec une mesure d’internement préventif », conclut-elle.
« Failles dans la détection précoce »
Beaucoup des cas arrivant pour la première fois à l’internement involontaire ont eu lieu, selon la spécialiste, en raison de « failles dans la détection précoce ».
« D’où l’importance à l’avenir de renforcer le soutien communautaire et les interventions, pour que moins de personnes arrivent au système déjà dans une première crise de telle gravité », avance-t-elle.
Par principe et par loi, l’internement involontaire est le dernier recours. Il est stipulé qu’il doit seulement être appliqué lorsque aucune autre forme de soins nécessaires au patient ne peut être assurée. La question est de savoir si, en pratique, c’est toujours ainsi.
Dans la grande majorité des cas, Susana Almeida Pinho est convaincue que oui. Que les professionnels optent pour l’internement involontaire seulement lorsqu’ils ont épuisé ou n’ont pas d’alternative, parce que « les psychiatres n’aiment pas interner quelqu’un contre sa volonté, étant une mesure de dernier recours, qui a des implications éthiques, ils tendent à essayer de convaincre le patient d’accepter un traitement volontaire, d’impliquer la famille, d’ajuster la médication en ambulatoire, etc. Du point de vue clinique, cela tende à être considéré comme dernier recours ».
Cependant, la médecin admet que, « si l’on regarde d’un point de vue systémique, on peut se demander : est-ce que certains internements involontaires ont lieu non parce que ‘tout a échoué’, malgré tous les efforts, mais parce qu’il manquait des ressources ou un soutien qui auraient pu éviter d’en arriver là ? Beaucoup de spécialistes soulignent que, en pratique, cela finit par être le dernier recours parce que le premier recours — qui serait un bon suivi de proximité — a échoué ».
« L’idée de la nouvelle loi, de privilégier le traitement involontaire en ambulatoire, heurte la réalité »
Il existe une pénurie de ressources en santé mentale ambulatoire au Portugal, tant en nombre de professionnels qu’en couverture des équipes communautaires. Ce manque de soutien psychiatrique ambulatoire a été signalé comme l’une des faiblesses de notre système de santé mentale et est directement liée aux internements involontaires.
Il n’est donc pas surprenant que « l’idée de la nouvelle loi, de privilégier le traitement involontaire en ambulatoire, heurte la réalité selon laquelle nous avons besoin d’équipes et de réponses communautaires suffisantes pour accompagner ces patients hors de l’hôpital », comme le souligne Susana Pinto Almeida, notant que, « actuellement, cette capacité est en augmentation, mais reste encore très limitée ».
« Ces dernières années, quelques équipes communautaires de santé mentale ont été créées, cependant, actuellement, de nombreuses régions ne disposent pas encore de ces équipes à plein », affirme, rappelant que « le Plan de relance et de résilience (PRR) et la réforme de la santé mentale prévoient d’élargir considérablement ces structures, en créant des dizaines de nouvelles équipes et en renforçant les soins continus et résidentiels ». Mais, dans la pratique, c’est encore en deçà des promesses.
« Les urgences psychiatriques de Lisbonne et Porto fonctionnent à pleine capacité »
Le suivi ambulatoire déficitaire, ainsi que la surcharge des urgences psychiatriques et le manque de professionnels compliquent la « réponse précoce et continue aux premiers signes de décompensation » et sont considérés comme étant les « principaux problèmes du système de santé mentale au Portugal ».
« Cela permet à de nombreux tableaux cliniques de s’aggraver jusqu’à atteindre un point de rupture, le « risque annoncé » que le système n’a pas pu contenir à temps. Les urgences psychiatriques des grands centres, comme Lisbonne et Porto, fonctionnent souvent à pleine capacité, sans places pour l’internement volontaire et avec de longs temps d’attente. Dans de nombreux cas, les patients sont renvoyés chez eux sans traitement adéquat, revenant dans un état plus grave quelques jours plus tard, moment où l’internement involontaire s’impose », révèle Susana Pinto Almeida, notant que ces « faiblesses structurelles créent un cercle vicieux », en d’autres termes, l’absence de réponse rapide conduit à l’aggravation de la maladie qui, à son tour, mène à l’internement involontaire.
La psychiatre expose également que « la pénurie de lits d’internement, le manque de techniciens et la désorganisation entre les différents niveaux de soins rendent le système réactif, plutôt que préventif ». « La solution consiste à renforcer la capacité de réponse rapide et communautaire. Cela implique d’investir dans des équipes de crise à domicile, d’augmenter le nombre de lits pour un internement bref, d’améliorer la coordination entre les urgences, l’ambulatoire et les services sociaux, et d’assurer plus de professionnels sur le terrain », défend-elle.
« Un système qui arrive trop tard »
La nouvelle Loi sur la santé mentale et les projets de réforme en cours vont dans ce sens, mais, sans mise en œuvre pratique, les internements involontaires continueront « à être le résultat prévisible d’un système qui arrive trop tard », défend Susana Pinto de Almeida.
« La pression sur les urgences et le manque de ressources contribuent à des internements involontaires évitables, qui résultent non pas de l’inévitabilité clinique, mais de l’incapacité à répondre rapidement. Traiter tôt, volontairement, reste la meilleure façon de prévenir l’internement forcé », assure-t-elle, soulignant qu’il y a une « absence de publication des plans régionaux et d’équipes communautaires fonctionnelles » qui « viole les délais et attentes légales, ce qui compromet l’esprit même de la législation ».
« Après la sortie, certains patients sont sans support »
« Ainsi, il est courant qu’après la sortie de l’hôpital certains patients se retrouvent relativement sans support, n’étant suivis qu’en consultation de routine avec des intervalles longs, ce qui augmente le risque de décompensation. Il y a un manque de traitement ambulatoire, suffisant et accessible, bien qu’on reconnaisse des efforts récents pour améliorer la situation. La nouvelle loi priorise l’ambulatoire involontaire, ce qui est positif, mais pour cela, il est impératif d’investir dans les ressources », fait valoir la psychiatre.
L’accompagnement après un internement involontaire « est essentiel » pour maintenir la convalescence, promouvoir la réhabilitation et prévenir les rechutes. Idéalement, le patient sort avec un plan de continuité des soins défini, y compris une consultation confirmée en ambulatoire ou un contact avec une équipe communautaire de santé mentale. Ce lien précoce garantit que l’adhésion à la médication et au suivi clinique soit renforcée dès les premiers jours, une phase critique pour éviter les décompensations.
Le soutien familial est un autre pilier. « Les familles informées sur la maladie et impliquées dans le plan thérapeutique sont souvent les premières à détecter les signes précoces de rechute. Lorsqu’il n’y a pas de réseau familial disponible, des ressources communautaires doivent être mobilisées pour assurer un support émotionnel et une surveillance informelle », attentionne la spécialiste, soulignant l’importance de « garantir aussi les conditions sociales minimales » des patients, c’est-à-dire, logement, revenu et activité.
« Le risque de rechute augmente si la personne quitte l’hôpital pour la solitude ou le vide. C’est pourquoi orienter le patient vers des activités communautaires aide à maintenir un lien social et une structure quotidienne. Les équipes de santé mentale doivent élaborer, avec le patient et sa famille, un plan de sécurité personnalisé, incluant des signaux d’alerte spécifiques, des stratégies d’action combinées et des contacts utiles en cas de crise. Ce plan permet d’anticiper les scenarios de risques et d’agir précocement, avant que la situation n’atteigne une gravité clinique », signale-t-elle.
En outre, « l’engagement actif du patient lui-même dans la gestion de sa santé mentale est essentiel ». Grâce à l’éducation à la santé, la personne peut apprendre à reconnaître ses propres signes précoces de décompensation, identifier les déclencheurs et chercher de l’aide de manière volontaire et rapide.
Enfin, la psychiatre souligne « la nécessité de structures formelles de recueil de feedback de la part des patients et des familles sur l’expérience d’internement et les soins reçus ».
« L’écoute active de ces témoignages est cruciale pour évaluer la qualité de la réponse thérapeutique et corriger les pratiques, s’assurant que les soins de santé mentale évoluent de façon participative et respectent véritablement la voix de ceux qui vivent le processus de l’intérieur. Un bon plan post-sortie combine suivi clinique structuré, soutien familial ou communautaire, stabilité sociale et outils de prévention. Lorsqu’il est bien articulé, il transforme l’internement involontaire en une réelle opportunité de réhabilitation et réduit la probabilité de retourner à une situation de danger et de perte de liberté », explique-t-elle.
Fin des internements involontaires ? Non, mais ils peuvent être moins fréquents
L’un des objectifs de la réforme de la loi sur la santé mentale est de réduire au maximum le nombre de personnes internées de manière involontaire. Cependant, leur extinction, comme certains le défendent, peut ne jamais être possible, comme le souligne Fernando Vieira au Notícias ao Minuto.
« Idéalement, il n’y aurait d’internement d’aucune spécialité, idéalement, les gens seraient traités à domicile. D’ailleurs, actuellement, il y a des chirurgies qui se réalisent en ambulatoire. Les gens font leurs analyses, viennent le jour même à l’hôpital, réalisent la chirurgie, sortent et sont suivis à la maison. La psychiatrie, en tant que spécialité médicale, n’échappe pas à la règle de toutes les autres spécialités. Maintenant, il est évident qu’il y a des aspects particuliers, car parfois, ces maladies affectent la propre capacité de consentir. Il existe des situations qui, pour l’instant, ne sont pas à notre portée, nous ne pouvons pas traiter autrement. Si un jour cela sera possible… bien, avec l’évolution, qui sait. Au Moyen-âge, jamais on ne croirait qu’il y aurait des voitures sans chevaux et aujourd’hui, il y a », plaisante-t-il.
Opinion similaire exprimée par Susana Pinto Almeida. « Même dans le meilleur système du monde, certains cas nécessiteront inévitablement un internement involontaire ».
Pour la psychiatre, « le plus grand défi des internements involontaires, actuellement, est de transformer la vision humaniste et progressiste de la nouvelle loi relative à la santé mentale en une pratique effective, dans un contexte de pénurie de ressources. La législation exige davantage de soins communautaires, une plus grande personnalisation et une révision constante de la mesure, mais le système de santé mentale portugais se heurte encore à de sérieuses limitations en ressources humaines, équipes sur le terrain et structures de soutien ».
Le défi numéro un est donc « d’assurer des alternatives communautaires viables pour éviter les internements ou en réduire la durée ». « Sans équipes communautaires, centres de jour, techniciens disponibles pour des visites à domicile et une coordination entre soins, la possibilité d’appliquer des mesures telles que le traitement involontaire en ambulatoire est compromise, et le risque est que la loi devienne « lettre morte », observe la psychiatre.
Un autre obstacle majeur est le temps d’adaptation culturel et institutionnel au nouveau paradigme. Médecins, juges, familles et patients doivent s’habituer à interpréter et appliquer la nouvelle législation, ce qui implique une formation technique et éthique, des changements de mentalité et une uniformisation des critères.
Le défi est aussi d’éclairer la société, souvent marquée par le stigmate, qui continue de voir l’internement comme solution immédiate, alors qu’il doit être exceptionnel et partie intégrante d’un plan plus large de réhabilitation.
« L’avenir des internements involontaires réside en la réduction de leur fréquence et durée, garantissant qu’ils ne surviennent que lorsqu’absolument nécessaires et toujours avec le maximum de dignité et d’engagement du patient. Cela implique d’investir dans les équipes communautaires prévues par la Réforme de la Santé Mentale, de renforcer les structures de soutien et de s’aligner sur les tendances internationales des droits humains », énonce Susana Pinto Almeida.
En résumé, « l’avenir souhaitable est un système de plus en plus ouvert, centré sur la personne et ses droits, où les internements involontaires sont courts, proportionnels et accompagnés d’une véritable réintégration communautaire. Mais pour y parvenir, le plus grand défi est clair : faire en sorte que la réalité accompagne l’ambition de la législation ».