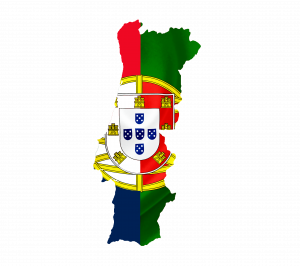Dans le document, le régulateur analyse les conséquences des accords entre entreprises concurrentes pour ne pas recruter réciproquement leurs travailleurs ou pour établir des ententes de recrutement massif, des stratégies que l’AdC affirme être soumises à l’examen de la politique de concurrence si ces pratiques mènent à l’exclusion d’autres entreprises ou limitent la mobilité des professionnels du secteur.
Selon le régulateur, les accords de non-recrutement de travailleurs de concurrents ou de fixation des salaires peuvent même représenter une infraction aux règles du marché. Le recrutement massif de travailleurs d’une entreprise concurrente peut également être considéré comme une opération de concentration à la lumière des règles de concurrence, souligne l’AdC.
Par exemple, « face à la pénurie de talents, les fournisseurs d’IA peuvent chercher à restreindre la mobilité professionnelle, limitant ainsi la manière dont leurs travailleurs peuvent quitter l’entreprise pour travailler chez des concurrents ou fonder leurs propres entreprises. Cela peut se faire en incluant dans les contrats de travail des clauses qui restreignent ce que les travailleurs peuvent faire hors de l’entreprise », indique l’AdC.
Il existe également des clauses de non-concurrence qui « peuvent restreindre la mobilité professionnelle en empêchant les anciens travailleurs de travailler pour des concurrents ou d’ouvrir des entreprises concurrentes après la fin de leur contrat de travail et pendant une certaine période ».
Il en va de même si les entreprises établissent « des accords de non-sollicitation et de non-recrutement » de collègues, car ces ententes « limitent la capacité des anciens employés à faire des offres spontanées, à recruter d’anciens collègues ou à fonder une nouvelle entreprise avec eux », mentionne l’AdC.
Comme ces stratégies « s’appliquent au secteur numérique dans son ensemble », l’AdC a mené une enquête auprès de 68 entreprises actives dans le secteur numérique au Portugal et a conclu que « la majorité inclut dans leurs contrats de travail, tant des clauses de non-concurrence que des clauses de confidentialité, ainsi que la cession des droits de propriété intellectuelle sur les découvertes, créations ou innovations ».
L’AdC précise que, à la lumière du droit européen, « ces clauses dans les contrats de travail ne relèvent pas d’éventuels accords anticoncurrentiels », c’est-à-dire qu’elles ne violent pas le Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne.
Toutefois, en restreignant la mobilité professionnelle, elles ont un effet « ambigu », car elles peuvent « réduire la concurrence sur les marchés du travail, diminuer les salaires, inhiber une allocation efficace du facteur travail et freiner la circulation et la diffusion des connaissances », avertit l’AdC.
D’autres types d’accords, tels que ceux de non-recrutement ou d’accords de fixation des salaires, « sont susceptibles d’enfreindre le droit de la concurrence ».
Dans le cas des entreprises présentes sur le territoire portugais, ces pratiques peuvent violer « notamment l’article 9 de la Loi de la Concurrence et, le cas échéant, l’article 101 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne, qui visent les cartels traditionnels », alerte l’AdC.
Le régulateur rappelle que la Commission Européenne a déjà qualifié ces deux types d’accords de « restrictions par objet » à la concurrence (c’est-à-dire qu’elle a considéré que ces pratiques, en elles-mêmes, visent à fausser la concurrence), se rapprochant « d’un cartel d’achats (où le travail est le facteur acquis) ».
L’AdC note que la mobilité professionnelle joue un rôle central dans la diffusion des connaissances, en particulier dans un secteur émergent comme celui de l’IA, d’où son avertissement que les stratégies de rétention de talents qui ont été adoptées peuvent nuire à la concurrence et freiner l’innovation.