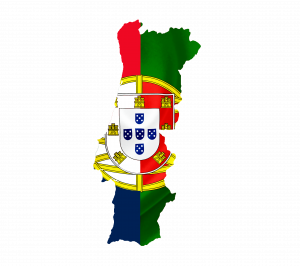Depuis que le président américain, Donald Trump, a repris ses fonctions en janvier dernier à la Maison Blanche, il a promis d’utiliser des tarifs additionnels contre plusieurs territoires comme une « arme » dans cette guerre commerciale, ce qui s’est concrétisé pour l’UE en mars.
Bien que la Commission européenne – qui détient la politique commerciale de l’UE – se soit toujours montrée prête à « combattre », elle n’a pas obtenu le résultat escompté de zéro tarif entre le bloc communautaire et les États-Unis.
Au lieu de cela, dimanche dernier, ces tensions ont été apaisées par un accord commercial fixant à 15 % les droits de douane américains sur les produits européens, qui prévoit également l’engagement de l’UE d’acheter de l’énergie américaine pour une valeur de 750 milliards de dollars (environ 642 milliards d’euros), un investissement supplémentaire de 600 milliards (514 milliards d’euros) et une augmentation des acquisitions de matériel militaire.
Les diplomates à Bruxelles ont vu cet accord comme les « tarifs les plus bas possibles » et une « occasion de stabiliser les relations transatlantiques », étant donné que l’UE et les États-Unis sont les plus grands partenaires commerciaux du monde, mais l’ambition européenne était plus grande, avec des tarifs zéro pour les biens industriels, comme l’avait proposé la Commission européenne.
Il a été possible d’atteindre un tarif unique de 15 % sur la majorité des biens exportés vers les États-Unis, au lieu des 30 % menacés par Donald Trump, exemptant des secteurs stratégiques comme les semi-conducteurs, les composants aérospatiaux et certains produits pharmaceutiques.
Voici une chronologie des principaux événements des derniers mois :
20 janvier
Le républicain Donald Trump débute son second mandat à la Maison Blanche.
Quelques jours plus tard, il annonce des tarifs de 25 % sur les produits du Canada et du Mexique et de 10 % sur les produits de la Chine.
L’Union européenne est mentionnée, mais non taxée. Le bloc communautaire réagit avec inquiétude face à la menace d’être visé dans des secteurs comme l’acier, l’aluminium, la machinerie et l’automobile.
12 mars
Les États-Unis appliquent des tarifs de 25 % sur l’acier et de 10 % sur l’aluminium à tous les pays, y compris l’UE, comme cela s’était déjà produit lors du premier mandat de Donald Trump.
L’UE annonce des représailles équivalentes, mais les suspend pendant 90 jours, offrant une marge pour des négociations.
13 mars
Donald Trump menace d’imposer une taxe de 200 % sur les vins et boissons européens. L’UE envisagée une réponse proportionnelle et évoque une incompatibilité avec l’Organisation mondiale du commerce (OMC), bien qu’elle préfère la voie des négociations.
26 mars
Donald Trump impose un tarif de 25 % sur les voitures importées et les pièces automobiles en provenance de l’Union européenne.
02 avril
Entrée en vigueur des 25 % des États-Unis sur les voitures de l’UE.
Trump présente un programme de taxations réciproques global, incluant 20 % sur les importations provenant de l’UE, à appliquer à partir du 09 avril.
07 avril
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, annonce avoir proposé des taxes zéro pour les biens industriels dans les échanges commerciaux entre l’UE et les États-Unis et être à l’écoute des entreprises communautaires pour adopter des contre-mesures communautaires.
09 avril
Donald Trump annonce la suspension pour 90 jours de l’application des nouveaux droits de douane à plus de 75 territoires, des négociations commerciales ayant lieu, notamment avec l’UE.
10 avril
La Commission européenne accueille favorablement l’annonce des États-Unis et suspend officiellement toutes les mesures de représailles concernant les droits de douane sur l’acier et l’aluminium pour 90 jours, appelant à un retour à l’accord de quotas de 2021.
11 avril
La Commission européenne publie les premières évaluations économiques des tarifs américains sur l’UE.
Les calculs de l’exécutif communautaire indiquent que les nouveaux droits de douane américains impliquent des pertes de 0,8 % à 1,4 % du produit intérieur brut (PIB) jusqu’en 2027, ce pourcentage étant de 0,2 % du PIB pour l’UE.
Dans le pire des cas, si les droits de douane sont permanents ou s’il y a d’autres contre-mesures, les conséquences économiques seraient plus négatives, de 3,1 % à 3,3 % pour les États-Unis et de 0,5 % à 0,6 % pour l’UE.
Globalement, l’exécutif communautaire estime une perte de 1,2 % du PIB mondial et une baisse de 7,7 % du commerce mondial en trois ans.
À l’époque, on parlait de taxes de 25 % sur l’acier, l’aluminium et les voitures européennes et de 20 % en taxes réciproques au bloc communautaire.
14 avril
La Commission européenne suspend officiellement les contre-mesures de l’Union européenne pour répondre aux droits de douane imposés par les États-Unis sur l’acier et l’aluminium communautaires jusqu’au 14 juillet pour permettre des négociations.
08 mai
La Commission européenne propose une liste de biens industriels et agricoles des États-Unis pour une valeur de 95 milliards d’euros, à taxer si les négociations avec Washington n’aboutissent pas, se préparant également à un litige devant l’OMC.
23 mai
Trump annonce des tarifs réciproques de 50 % sur les biens de l’UE, initialement prévus pour le 01 juin, puis reportés au 09 juillet.
L’exécutif communautaire commence à recenser les biens américains pour des représailles.
09 juillet
Date limite informelle établie par les États-Unis pour les négociations sur les tarifs réciproques, par la suite ajournée.
Rien ne se passe et l’administration américaine commence à se concentrer sur une autre échéance, le 01 août.
12 juillet
Donald Trump annonce officiellement des tarifs réciproques de 30 % sur les biens de l’UE (et du Mexique), débutant le 01 août, abaissant le pourcentage initialement fixé à 50 %.
14 à 21 juillet
L’UE intensifie ses préparatifs de représailles, mais accentue ses efforts de négociation (au niveau technique et politique) pour un accord préliminaire.
Le dialogue se poursuit et des premières indications de convergence vers un tarif de 15 % apparaissent.
24 juillet
La Commission européenne adopte un paquet total de représailles évalué à 93 milliards d’euros.
À la mi-juillet, l’exécutif communautaire avait proposé une liste de biens importés des États-Unis, totalisant 72 milliards d’euros, à taxer si l’administration américaine imposait des tarifs réciproques.
Sont en cause 6,4 milliards d’euros de produits agroalimentaires et 65,8 milliards d’euros de biens industriels, dont les aéronefs et les pièces aéronautiques, les automobiles et leurs pièces, la machinerie, les produits chimiques et plastiques, les dispositifs médicaux et l’équipement électrique.
Il s’agissait d’un second paquet faisant suite à un premier de 21 milliards d’euros, publié en mars et conçu comme réponse aux tarifs américains sur l’acier et l’aluminium.
Au total, l’UE s’était préparée à imposer des tarifs de représailles sur des biens en provenance des États-Unis d’une valeur de 93 milliards d’euros.
27 juillet
Donald Trump et Ursula Von der Leyen se rencontrent au complexe de golf du républicain à Turnberry, dans le sud-est de l’Écosse.
Ils annoncent un accord commercial évitant une guerre commerciale prononcée.
Les parties s’accordent pour que les États-Unis appliquent un tarif de 15 % sur la plupart des exportations de l’UE, au lieu des 30 % menacés, à l’exception des produits stratégiques (aéronefs et composants, produits chimiques, droguerie générique, équipement semi-conducteur), avec des tarifs bilatéraux nuls.
Les tarifs sur l’acier et l’aluminium demeurent, mais seront remplacés par un système de quotas.
L’accord est encore préliminaire et non totalement officiel, avec des détails en attente.