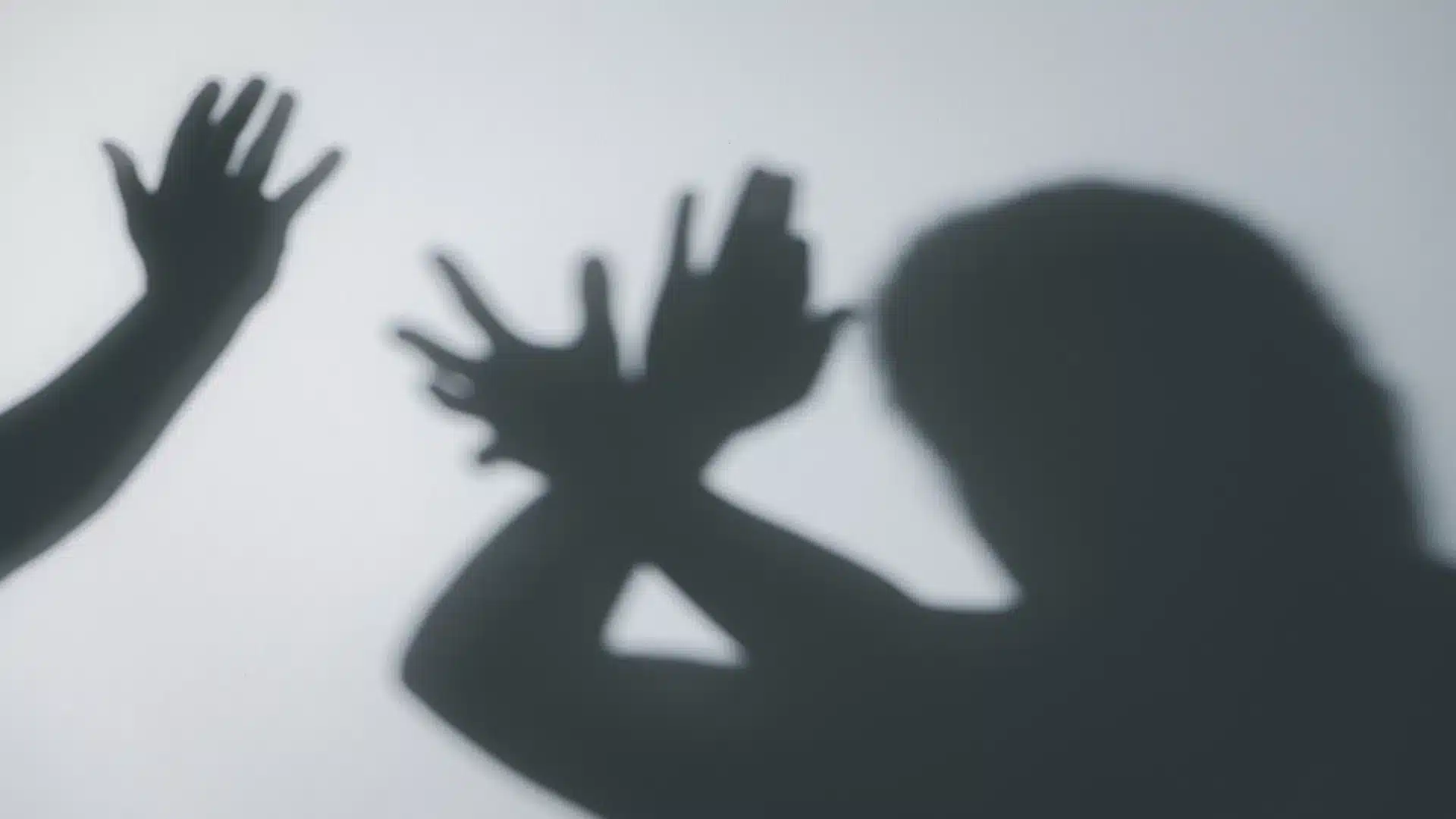Les statistiques les plus récentes de l’APAV concernant les victimes masculines, relatives à la période entre 2022 et 2024, révèlent que l’association a soutenu 10 261 personnes, soit une augmentation de 23 % au cours de ces trois années.
Dans une interview à l’agence Lusa, Daniel Cotrim a expliqué que cette évolution est liée à une prise de conscience accrue sur le thème de la violence, mais a rappelé qu’« il y a toujours l’autre côté de la médaille ».
« Pour chacune de ces victimes soutenues, de ces 10 200 victimes de sexe masculin soutenues, nous savons, car c’est ce que nous indiquent les études d’incidence et de prévalence, qu’il y a toujours au moins deux personnes, deux hommes, qui ne vont pas dénoncer la situation », a-t-il révélé.
Cela signifie que le nombre de victimes masculines demandant de l’aide à l’APAV pourrait dépasser les 30 700.
« Nous avons toujours la notion que la réalité est bien supérieure à celle que l’on voit à travers les chiffres qui nous sont présentés via les demandes d’aide qui nous parviennent », a-t-il affirmé, en indiquant que c’est pour cette raison qu’« il est toujours compliqué » d’affirmer que la violence est en hausse.
Selon le responsable, cette difficulté à demander de l’aide est également liée à l’« idée profondément stéréotypée » et « pleine de préjugés » que la société a encore sur la condition de victime, où « les victimes sont des femmes » et le mot « victime est très associé, à tort, à une idée de fragilité et de vulnérabilité ».
« Ce que la société perçoit, c’est que les hommes ne sont pas fragiles ni si vulnérables et ce que ces données nous montrent est exactement le contraire, c’est-à-dire, les hommes sont aussi vulnérables aux situations de victimisation que les femmes, donc ce n’est pas une question de genre », a-t-il souligné.
Par ailleurs, il a expliqué que la honte et la peur du jugement des autres rendent également difficile le fait de parler de violence, ce qui, selon lui, renvoie aux questions de masculinité et de ce que signifie être homme ou non.
Il a indiqué que les trois crimes les plus signalés à l’APAV renvoient « à des questions de fragilité et de vulnérabilité », à savoir la violence domestique, avec 11 906 crimes dénoncés, mais aussi des crimes d’atteinte à l’intégrité physique (885) et des crimes de menace/abus de pouvoir (731).
D’un autre côté, 36,6 % des victimes masculines ayant demandé de l’aide à l’APAV ont été victimes de violence continue, une donnée expliquée par le fait que « la grande majorité des demandes d’aide des hommes se situent dans le cadre de la violence domestique » et que la « violence domestique est un crime continué ».
Daniel Cotrim a expliqué que, dans le cas de la violence domestique, « l’escalade de la violence est très rapide », avec des cas d’homicides, et que c’est ce cycle de violence qui est à l’origine du retard dans le dépôt de la plainte, 19,8 % des victimes mettant entre deux et six ans, et 10,9 % ayant besoin de douze ans ou plus.
Associée à l’escalade de violence vient également la honte : « ce n’est pas naturel dans la tête des hommes qu’une femme soit l’agresseur, donc un homme a la capacité prétendue de se défendre, mais c’est un mythe, un stéréotype », a-t-il souligné.
La même idée de masculinité explique que le premier contact de ces victimes avec le système de protection se fasse via l’APAV et non avec la police ou le tribunal, Daniel Cotrim ayant admis que le système « n’est pas clément avec les hommes » et a encore « beaucoup de préjugés en mélange ».
Pour le responsable, le travail pour l’avenir doit continuer à passer par l’éducation et la prévention, en investissant dans l’égalité de genre dans les écoles et en parlant des rôles des hommes et des femmes, de comment ils se complètent, tout en prenant « la figure masculine comme victime est à regarder ceci de façon parfaitement naturelle » et en « déconstruisant les idées fausses de la masculinité toxique ».
Pour Daniel Cotrim, c’est un travail qui a été fait, mais doit être poursuivi, soulignant que les discours de misogynie sont de plus en plus présents et alertant sur les jeunes adolescents qui ont « un accès direct à ce type de discours ».