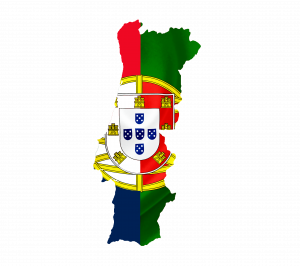Selon la Fondation Gulbenkian, la Coalition pour l’Antarctique et l’Océan Austral (ASOC), fondée en 1978 et regroupant environ 20 organisations environnementales de 10 pays, « est un exemple de la manière dont le travail collaboratif international, la défense de causes fondées sur des arguments scientifiques et la promotion d’une gestion environnementale éthique et durable sont essentiels pour garantir un avenir durable pour l’humanité ».
Basée à Washington, l’ASOC a été sélectionnée par le jury du prix, présidé par l’ancienne chancelière allemande Angela Merkel, parmi 212 entités nommées par 115 pays.
La directrice exécutive de l’ASOC, Claire Christian, a déclaré à l’agence Lusa que « dans une période très difficile en termes de financement des organisations environnementales, le prix permettra de développer le travail dans des domaines où, ces derniers temps, il n’y avait pas de ressources disponibles ».
« Nous pourrons élargir notre travail et soutenir des projets comme la création de zones marines protégées. Nous essayons de convaincre les pays administrant l’Antarctique, via le Système du Traité Antarctique, de créer quatre nouvelles grandes zones marines protégées dans l’Océan Austral, la partie de l’océan mondial entourant le continent polaire.
L’Antarctique concentre environ 90% de toute la glace terrestre et environ 70% de toute l’eau douce, tandis que l’Océan Austral génère les courants marins les plus puissants, qui circulent dans les eaux de l’océan global, régulant la température de la planète et distribuant des nutriments qui soutiennent une biodiversité formant la base de toute la chaîne alimentaire marine.
Bien que lointaine, la région antarctique et l’Océan Austral sont parmi les plus vulnérables aux changements climatiques, avec des anomalies de température extrêmes enregistrées, une perte accélérée de glace marine, et des parties de l’Antarctique affichant des taux de réchauffement plus de deux fois supérieurs à la moyenne mondiale, avec des impacts croissants résultant de l’activité humaine, comme la pollution due à l’augmentation du trafic maritime liée à la pêche et au tourisme.
Le Prix Gulbenkian pour l’Humanité a été institué en 2020 pour distinguer des individus ou des organisations du monde entier dont le travail a contribué à atténuer l’impact des changements climatiques.
La première édition du prix a distingué l’activiste suédoise Greta Thunberg, en 2021, le Prix Gulbenkian pour l’Humanité a été attribué au Pacte Mondial des Maires pour le Climat et l’Énergie, et en 2022, au Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) et à la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES).
En 2023, le prix a distingué Bandi « Apai Janggut », chef traditionnel de la communauté indigène indonésienne Dayak Iban Sungai Utik, Cécile Bibiane Ndjebet, activiste environnementale camerounaise, et Lélia Wanick Salgado, activiste brésilienne qui a créé l’Instituto Terra avec le célèbre photographe Sebastião Salgado.
En 2024, le prix a été attribué au programme d’État indien de soutien aux petits agriculteurs Andhra Pradesh Community Managed Natural Farming, à Rattan Lal, scientifique indo-américain dont le travail est centré sur l’agriculture régénérative, et à SEKEM, une plateforme d’ONG, d’entreprises et d’une université centrée sur le développement durable.